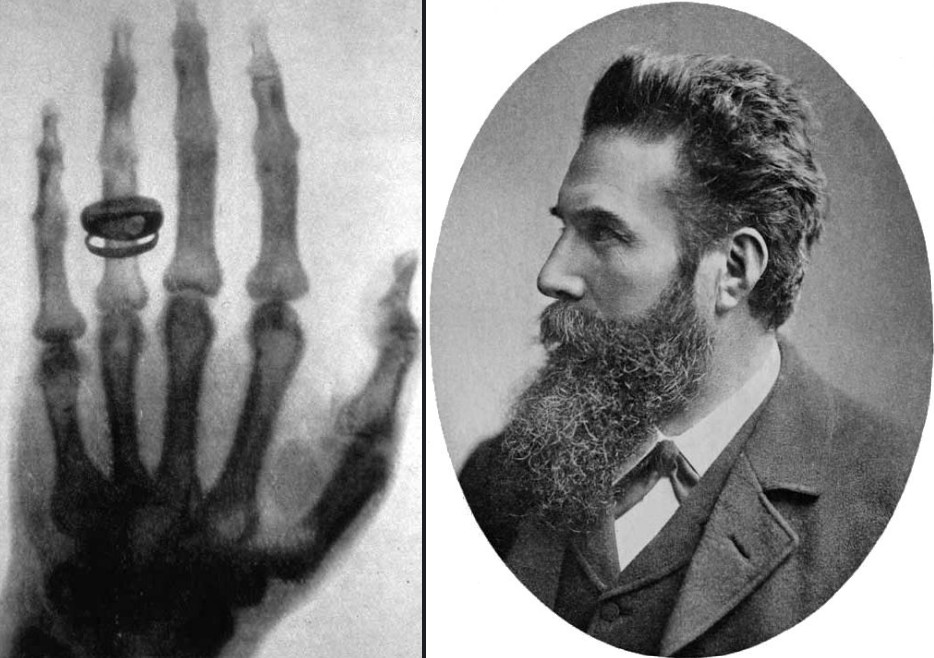Le 7 septembre 1995, l’éthologue américain John B. Calhoun quitte ce monde, laissant derrière lui une œuvre scientifique aussi fascinante que dérangeante. Spécialiste du comportement animal, Calhoun n’a pas seulement observé des rongeurs : il interroge en profondeur la place de l’individu dans la société, le rapport à l’espace, à l’autre, à la communauté.
Avec son expérience baptisée « Univers 25 », il propose au monde bien plus qu’un simple test en laboratoire : un miroir, où l’on devine en filigrane nos propres espoirs et nos pires inquiétudes sur l’avenir des sociétés humaines. Sa disparition marque la fin d’une carrière atypique, mais l’écho de ses conclusions résonne toujours auprès des chercheurs, philosophes, urbanistes et simples citoyens.
Sommaire
Un paradis qui tourne au cauchemar
Dans les années 1960 et 1970, John B. Calhoun imagine une expérience radicale pour étudier l’effet de la surpopulation en laboratoire. Il aménage pour des souris un environnement idéal : nourriture illimitée, eau pure, abris confortables, aucun risque de maladie ou de prédation, un climat parfaitement maîtrisé.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Au départ, l’espace respire le bien-être et la sécurité. Les souris s’installent, se multiplient : la colonie croît de façon exponentielle. Mais, très vite, la promiscuité transforme ce paradis en véritable piège. Le stress social s’installe, et avec lui, des comportements que Calhoun n’avait jamais observés auparavant : bagarres incessantes, blessures non soignées, retrait de certains individus devenus « spectateurs passifs » ou « beautiful ones », qui se consacrent exclusivement à leur apparence. D’autres manifestent une agressivité pathologique ou ne s’occupent plus de leurs petits, qui meurent délaissés.
Finalement, même si les conditions restent parfaites sur le plan matériel, la colonie s’effondre : plus aucun couple ne se forme, les naissances cessent, l’ensemble disparaît. Un drame total, au cœur de l’abondance.
Que nous dit cette expérience ?
L’analyse que Calhoun fait de ses observations va bien au-delà de la biologie animale. Il voit dans la crise traversée par ses souris une puissante analogie avec le destin potentiel des sociétés humaines en cas de surpopulation et de pression sociale excessive. Selon lui, le manque d’espace vital, l’absence d’intimité, la saturation des interactions sociales peuvent déstabiliser même les structures les plus stables. Se développent l’angoisse, l’agressivité, la perte de sens, jusqu’à la rupture du contrat social.
L’expérience pose la question du besoin universel d’équilibre entre le collectif et l’individuel, entre la proximité et la distance, entre la compétition et la coopération. De nombreux scientifiques, tout comme Calhoun, nuancent tout de même ce parallèle en soulignant la spécificité de l’humain : sa capacité unique à inventer de nouvelles formes d’organisation, de lois, à entretenir le lien malgré la contrainte. Là où le rat finit par céder sous la pression, l’homme, lui, peut bâtir, par la culture, l’éducation, la solidarité, des défenses qui rendent possible la vie commune – même en milieu dense.
Quelles solutions peut-on adopter ?
Si cette expérience ne prédit pas littéralement le futur de l’humanité, elle donne matière à réflexion sur la façon dont nous pouvons rendre compatible densité humaine et harmonie sociale.
D’abord, elle met en garde : garantir l’accès équitable aux ressources est un préalable essentiel. C’est moins la quantité d’humains que la qualité des échanges, la justice sociale et la possibilité pour chacun de « trouver sa place » qui comptent. Calhoun nous invite à cultiver l’espace personnel, l’intimité, condition du bien-être mental, et à réfléchir à la conception de nos villes et nos logements. Il rappelle aussi qu’une société solidaire, riche en liens de confiance, en entraide, en projets partagés, résiste mieux au stress et à la crise.
Enfin, il nous met en garde contre la tentation de la croissance pour elle-même : il s’agit de veiller à ce que chaque nouvel individu soit accueilli dans des conditions sociales, psychologiques et urbaines propices à son épanouissement, favorisant l’implication, la créativité, et l’action collective.
Quel avenir pour la démographie mondiale ?
Au moment où ces questions se posent avec acuité, la population de la Terre atteint 8 milliards et continue sa progression. Pourtant, les modèles démographiques montrent aujourd’hui que cette croissance va ralentir puis s’arrêter, atteignant un pic autour de 2080, à près de 10,3 milliards d’individus. Après ce sommet, la planète devrait entrer lentement dans une phase de déclin démographique.
Ce tournant inédit résulte d’une révolution silencieuse : partout, le taux de fécondité baisse, porté par l’accès à la contraception, l’éducation des filles, l’urbanisation, le choix de familles moins nombreuses. Si l’Afrique reste un pôle de croissance, l’Europe, la Chine et l’Inde voient vieillir et parfois diminuer leur population. Ce basculement démographique annonce de nouveaux défis : gestion du vieillissement, mobilité humaine, partage des ressources, maintien des solidarités dans des sociétés parfois moins nombreuses mais plus âgées.
Quelles explications à cette évolution ?
La transition démographique mondiale est avant tout l’expression du passage d’une société rurale et traditionnelle, où avoir beaucoup d’enfants garantit la sécurité de la famille, à une société urbaine et moderne, où prime la recherche de la qualité de vie. L’augmentation du niveau d’éducation, la promotion des droits des femmes, la diffusion de la contraception, la hausse du coût de la vie, mais aussi le désir de plus d’autonomie et de choix personnel, réduisent le nombre d’enfants par famille.
L’humanité apprend à contrôler son destin démographique, non par la contrainte, mais par la prise de conscience, la planification et l’adaptation à de nouveaux équilibres sociaux. Cette transformation, qui s’étend progressivement à la quasi-totalité du globe, rend possible la stabilisation de la démographie avant la fin du siècle.
L’expérience Univers 25 pose, encore aujourd’hui, une question fondamentale : que voulons-nous faire de nos sociétés ? Allons-nous choisir la rivalité, l’isolement, la compétition, ou donnerons-nous du sens à la proximité, à l’interdépendance, à la solidarité ? Serons-nous plus intelligents que les souris ?
Illustration: Image générée par IA