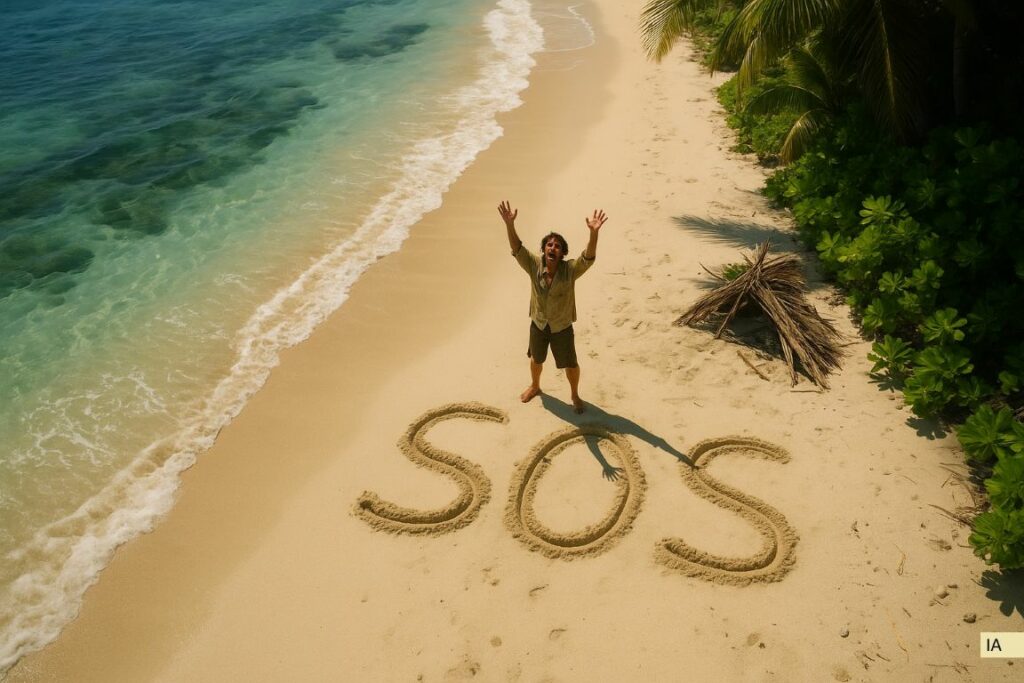Le 29 septembre 1957, au cœur de l’Oural soviétique, l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire vient bouleverser la vie de milliers de personnes. L’accident de Kychtym, longtemps tenu secret par les autorités, frappe le complexe nucléaire de Maïak et laisse derrière lui une région silencieuse, meurtrie et marquée à jamais.
Aux origines du drame
À Kychtym, la fierté soviétique réside dans ce gigantesque complexe industriel, où l’on produit et retraite le plutonium militaire. Mais ce 29 septembre, tout bascule : une banale panne dans le système de refroidissement d’un réservoir souterrain de déchets radioactifs passe inaperçue. Les jours passent, la température grimpe, jusqu’à ce que la réaction chimique devienne incontrôlable. À 16h20, une explosion phénoménale pulvérise le couvercle en béton du réservoir et projette des dizaines de tonnes de substances radioactives dans l’atmosphère, contaminant plus de 20 000 km² et touchant jusqu’à 270 000 habitants.
Un désastre caché, une population sacrifiée
Face à cette catastrophe hors norme, l’État soviétique opte pour le secret absolu. Les populations riveraines sont évacuées à la hâte, sans explications. On efface des villages de la carte, on enferme la région dans le silence. Les irradiés affluent vers des hôpitaux vite débordés, sans que personne ne prononce un mot sur les causes du mal qui les frappe. Il faudra près de 20 ans pour que la vérité finisse par filtrer à l’Ouest : la CIA, bien qu’informée, choisit elle aussi de protéger le silence autour de l’accident pour préserver ses propres intérêts nucléaires.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Les blessures perdurent
Aujourd’hui encore, la rivière Techa et les lacs autour de Maïak restent parmi les endroits les plus pollués au monde. Des familles vivent dans des villages fantômes, exposées à une radioactivité qui s’infiltre partout : dans l’eau, le lait, les récoltes. Les cancers et malformations explosent, le taux de maladies chroniques dépasse largement la moyenne nationale. L’État accorde une reconnaissance minimale aux victimes, mais ne commémore toujours pas officiellement le drame. Kychtym demeure une cicatrice cachée, un « accident grave » classé niveau 6 sur l’échelle INES, juste derrière Tchernobyl et Fukushima.
Aujourd’hui encore, malgré le temps et l’omerta, la région paie le prix des erreurs d’hier. Ceux qui y vivent continuent d’endosser le poids invisible de la radioactivité, tandis que la mémoire officielle, elle, reste étrangement silencieuse. Il apparait donc capital de faire vivre la mémoire d’une telle catastrophe que certains irresponsables voudraient enfouir profondément à tout jamais.
Illustration: Panneau de signalisation de la zone contaminée (Auteur: Ecodéfense, Heinrich Boell Stiftung Russie, Alla Slapovskaya, Alisa Nikulina). – Wikipédia