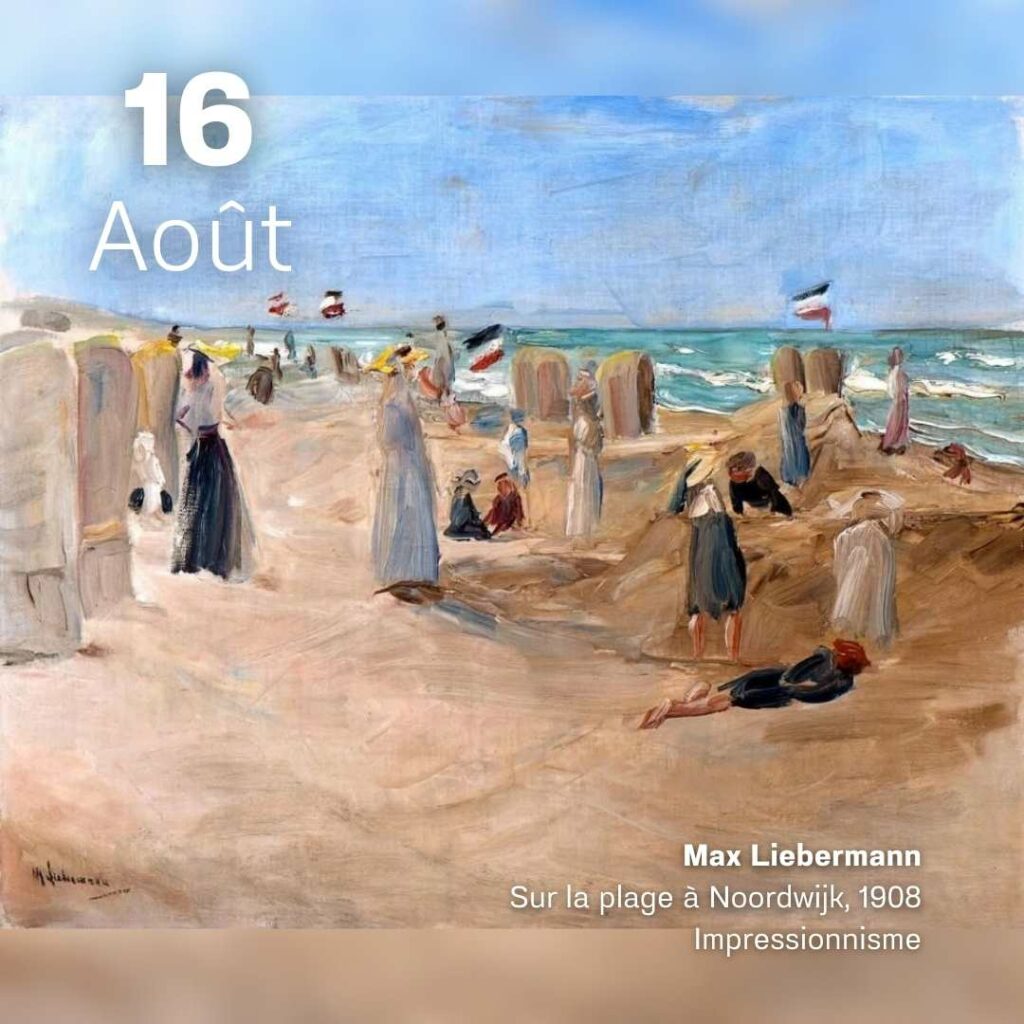Hugues Duroy de Chaumareys, figure tragique du naufrage de La Méduse, incarne les dérives d’une époque où la fidélité politique primait parfois sur la compétence. Le 3 mars 1817, il est condamné à trois ans de prison pour sa responsabilité dans la catastrophe, reconnu coupable de l’échouage du navire, de son abandon prématuré et de la désastreuse gestion du radeau qui a suivi. Cette sentence s’accompagne d’une dégradation militaire : il est rayé de la liste des officiers de la marine, privé de ses décorations, et déclaré inapte à servir à nouveau.
Sommaire
Retour aux affaires des fidèles du régime
Noble royaliste, Chaumareys avait vu sa carrière maritime s’interrompre brutalement après la Révolution. Lorsque la monarchie est restaurée, il bénéficie du retour en grâce des fidèles du roi. Malgré plus de vingt ans loin de la mer, il obtient le commandement de La Méduse en 1816, non pour ses compétences, mais pour sa loyauté envers la Couronne. Cette nomination illustre la politique de la Restauration, qui cherche à placer des hommes sûrs à des postes clés, quitte à négliger l’expérience nécessaire à la navigation de navires de guerre dans des mers inconnues.
De graves erreurs de commandements
Le drame se noue dès le départ de Rochefort. Chaumareys, peu au fait des techniques de navigation modernes, s’isole en distançant les navires d’escorte. Il refuse d’écouter les mises en garde de ses officiers, souvent d’anciens napoléoniens qu’il méprise, et accorde une confiance aveugle à un passager, Richefort, qui se prétend connaisseur des côtes africaines. Le 2 juillet 1816, guidé par des calculs erronés et une obstination dangereuse, il fait raser les hauts-fonds du banc d’Arguin au lieu de les contourner. La Méduse s’échoue à une soixantaine de kilomètres des côtes mauritaniennes. Les tentatives de renflouement échouent, et une tempête achève de briser la frégate, rendant l’abandon inévitable.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
L’abandon dramatique de la Méduse
La décision d’abandonner le navire, prise le 5 juillet, plonge l’équipage et les passagers dans l’angoisse : les canots de sauvetage sont en nombre insuffisant. Un radeau de fortune, construit à la hâte, doit accueillir environ 150 personnes, principalement des soldats et des membres d’équipage. Le plan initial prévoit que les chaloupes remorquent le radeau jusqu’au rivage. Mais, deux heures après le départ, les amarres sont coupées ou cèdent, et le radeau est livré à lui-même, balloté par la mer et abandonné à une dérive mortelle.
Commence alors l’une des pires tragédies maritimes du XIXe siècle. Pendant treize jours, les naufragés du radeau affrontent la faim, la soif, la violence et la folie. Les vivres s’épuisent en quelques jours, la promiscuité et la panique engendrent des scènes de violence extrême. Certains se jettent à la mer, d’autres sont passés par-dessus bord lors de mutineries. La faim pousse les survivants au cannibalisme. Sur les 150 personnes embarquées sur le radeau, seuls 15 sont secourus par le brick Argus le 17 juillet, et cinq d’entre eux succombent peu après leur sauvetage tant ils sont affaiblis.
Condamnation d’un homme et de sa famille
À son retour en France, Chaumareys doit affronter un procès retentissant. L’opinion publique, bouleversée par les récits des survivants, réclame justice. Le conseil de guerre, réuni à Rochefort, examine longuement sa conduite. Il est reconnu coupable d’avoir provoqué le naufrage par incompétence et négligence, d’avoir abandonné son navire et ses hommes, et d’avoir sacrifié le radeau. Sa condamnation à trois ans de prison, assortie de la perte de ses titres et de son honneur, marque la chute d’un homme autrefois protégé par son rang.
Après sa libération, Chaumareys se retire dans le château familial de Lachenaud, à Bussière-Boffy, auprès de sa mère. Mais il ne trouve ni paix ni rédemption. Accablé par les dettes, isolé et rejeté par la société, il finit ses jours dans la tristesse et le remords. À sa mort, la saisie du château entraîne le suicide de son fils, ajoutant une ultime note tragique à une destinée déjà marquée par le malheur.
La tragédie qui a inspiré Géricault
Le naufrage de la Méduse devient rapidement un scandale national. Les récits des survivants, publiés et largement diffusés, soulèvent l’indignation et la compassion. La presse s’empare de l’affaire, la société s’interroge sur les responsabilités, et le pouvoir politique est ébranlé. Cette tragédie inspire des œuvres majeures, dont le tableau de Géricault, et marque durablement la conscience collective.
Théodore Géricault immortalise ce drame humain dans son œuvre célèbre « Le radeau de la Méduse« , peinte entre 1818 et 1819. Cette peinture à l’huile sur toile de grandes dimensions (491 x 716 cm) représente le moment où les survivants aperçoivent le navire de secours. Géricault réalise des recherches approfondies, rencontrant des survivants et étudiant des cadavres pour rendre la scène avec réalisme. L’œuvre marque une rupture avec la peinture néoclassique et devient une figure emblématique du mouvement romantique.
Illustration: Le radeau de la Méduse, Théodore Géricault, 1818-1819