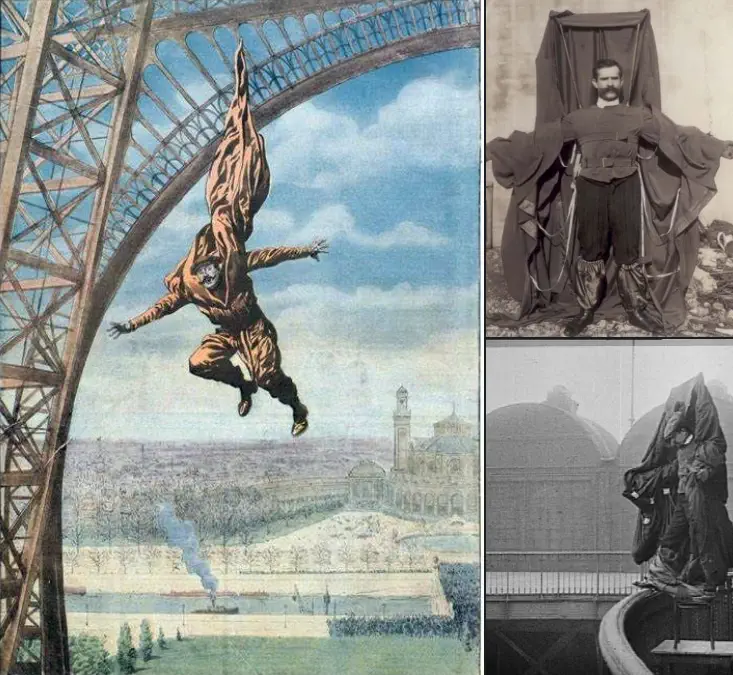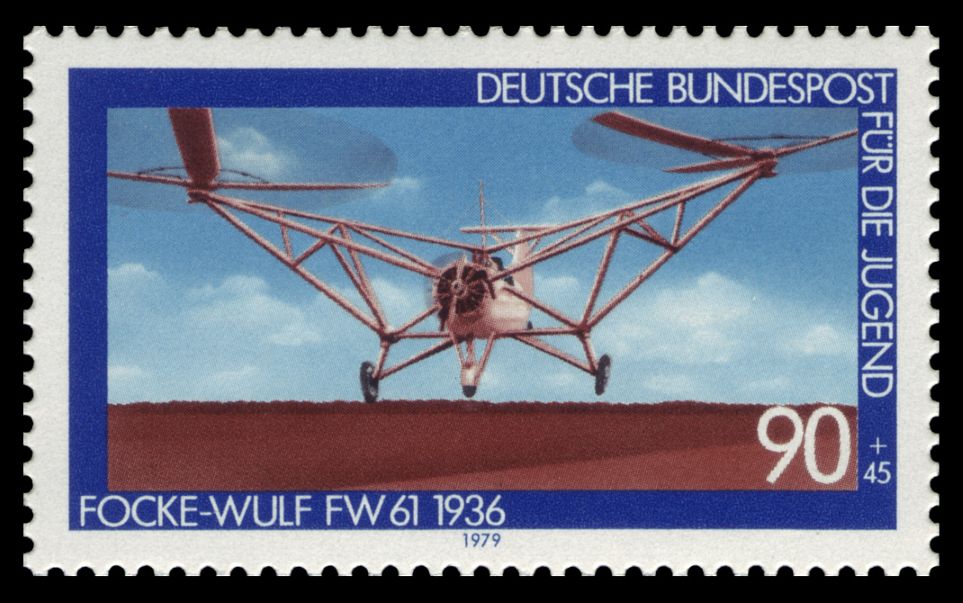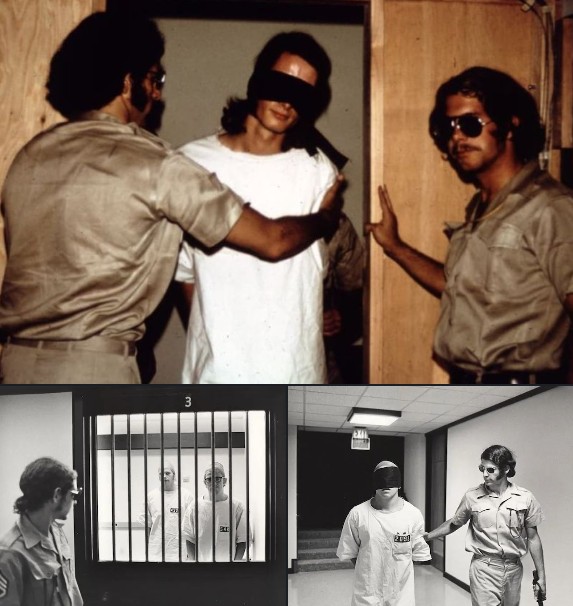Le 14 mars est célébré comme le jour de Pi et par extension le jour des mathématiques car cette date, écrite en notation américaine (3/14), correspond aux trois premiers chiffres de cette constante mathématique (3,14). Cette tradition a débuté en 1988 à l’Exploratorium de San Francisco, où le physicien Larry Shaw a organisé la première célébration officielle. La journée a gagné en reconnaissance nationale aux États-Unis en 2009, lorsque le Congrès américain a officiellement désigné le 14 mars comme Journée nationale de Pi.
Pi fascine l’humanité depuis des millénaires pour plusieurs raisons fondamentales. D’abord, sa nature mathématique est unique : c’est un nombre irrationnel et transcendant dont le développement décimal est infini et ne présente aucun schéma répétitif. Cette propriété a conduit à une théorie fascinante selon laquelle Pi pourrait contenir toutes les séquences numériques possibles, encodant potentiellement chaque histoire jamais écrite ou qui le sera. De plus, Pi apparaît de façon inattendue dans des domaines mathématiques sans lien apparent avec les cercles, comme la probabilité que deux nombres entiers aléatoires soient premiers entre eux. Comme l’a si bien dit le mathématicien William L. Schaaf : « Probablement aucun symbole en mathématiques n’a évoqué autant de mystère, de romantisme, de conceptions erronées et d’intérêt humain que le nombre pi ».
Pi intervient de façon cruciale dans les calculs liés aux sphères et aux phénomènes ondulatoires. Dans l’étude des sphères, Pi est essentiel pour calculer la surface (4πr²) et le volume (4/3πr³) de ces objets tridimensionnels. Cette constante est également fondamentale dans les équations décrivant les phénomènes ondulatoires. Que ce soit pour les ondes sonores, lumineuses ou électromagnétiques, Pi apparaît dans les formules qui régissent leur comportement. Les scientifiques utilisent Pi pour comprendre comment les ondes se propagent, ce qui permet de déterminer tout, de la conception acoustique des salles de concert au traitement des signaux dans les réseaux Wi-Fi. En physique quantique, Pi intervient dans le principe d’incertitude de Heisenberg, exprimé par la relation ΔxΔp ≥ ħ/2, où ħ = h/(2π) est la constante de Planck réduite.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Les cercles et les sphères influencent profondément notre compréhension de l’univers depuis l’Antiquité. Les premiers modèles cosmologiques, développés par des penseurs comme Anaximandre et Anaximène, utilisaient déjà des concepts de sphères célestes pour expliquer les mouvements des corps célestes. Dans ces modèles, les étoiles étaient considérées comme fixées sur une sphère cristalline en rotation. Cette idée a évolué avec Eudoxe, Aristote et Ptolémée, qui ont développé des modèles cosmologiques utilisant des sphères concentriques pour expliquer les mouvements planétaires. Ces modèles ont influencé notre perception du cosmos pendant des siècles. Aujourd’hui encore, nous utilisons la sphère céleste comme outil conceptuel pour cartographier et comprendre le « ballet céleste ». Cette sphère imaginaire entourant la Terre, sur laquelle nous projetons les étoiles, est parcourue de cercles imaginaires qui servent d’outils précieux pour la mesure et la compréhension astronomiques.
Pi, les cercles et les sphères sont omniprésents dans notre vie quotidienne, souvent sans que nous en prenions conscience. Dans la nature, Pi émerge dans de nombreux phénomènes, des ondulations créées par une goutte de pluie sur un étang aux motifs de croissance des plantes qui maximisent leur exposition au soleil. En ingénierie et technologie, Pi sous-tend des calculs critiques qui façonnent les technologies modernes, des instruments de précision comme les accéléromètres aux systèmes de télécommunications. Les architectes et ingénieurs en construction utilisent Pi pour concevoir des structures courbes, calculer les matériaux nécessaires pour un dôme ou déterminer la distribution des charges dans un arc. Même dans le sport, Pi est utilisé pour calculer la courbure optimale d’un ballon de basket ou l’aérodynamisme d’une raquette de tennis. Dans l’exploration spatiale, les scientifiques et ingénieurs utilisent Pi pour calculer les trajectoires des vaisseaux spatiaux et déterminer les positions des corps célestes.
La relation entre le jour de Pi, Einstein et Hawking constitue une fascinante coïncidence cosmique. Albert Einstein, l’un des plus grands physiciens de tous les temps, est né le 14 mars 1879, jour que nous célébrons maintenant comme le jour de Pi. De façon remarquable, Stephen Hawking, autre géant de la physique théorique, est décédé le 14 mars 2018. Cette coïncidence est d’autant plus frappante que Hawking était surnommé « Einstein » à l’école. Les deux physiciens ont vécu jusqu’à l’âge de 76 ans. Pi apparaît dans divers domaines des mathématiques qui sont cruciaux pour les théories d’Einstein et de Hawking. Bien que certains puissent être tentés d’y voir une signification mystique, il s’agit simplement d’une coïncidence extraordinaire. Comme l’a dit Hawking lui-même : « Une des règles fondamentales de l’univers est que rien n’est parfait. La perfection n’existe tout simplement pas. Sans imperfection, ni vous ni moi n’existerions ».
Illustration: Bing Image Creator