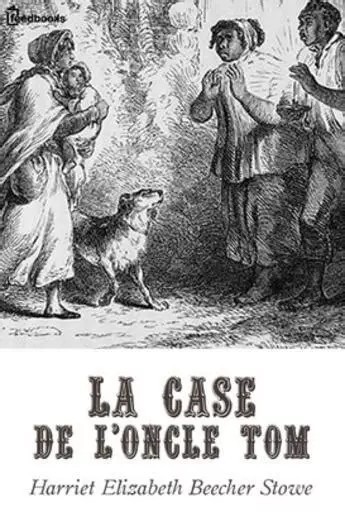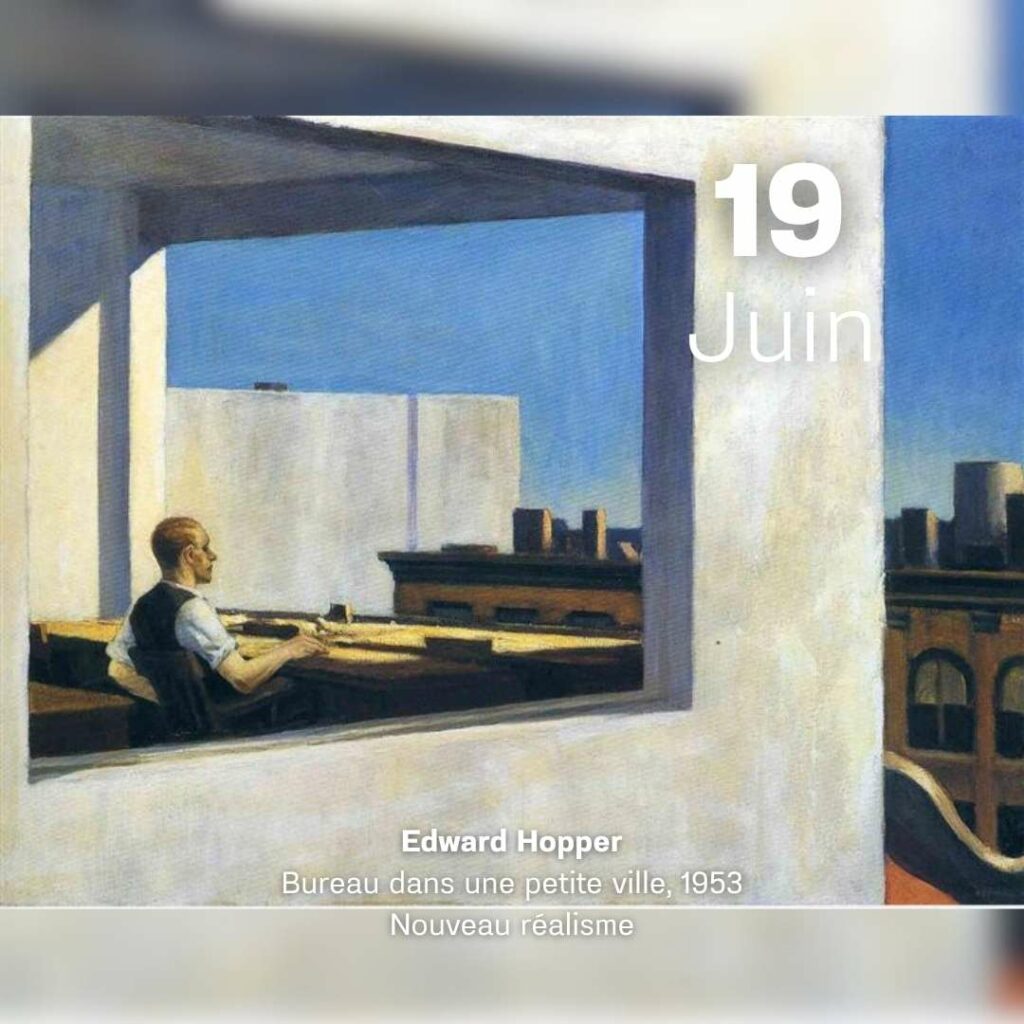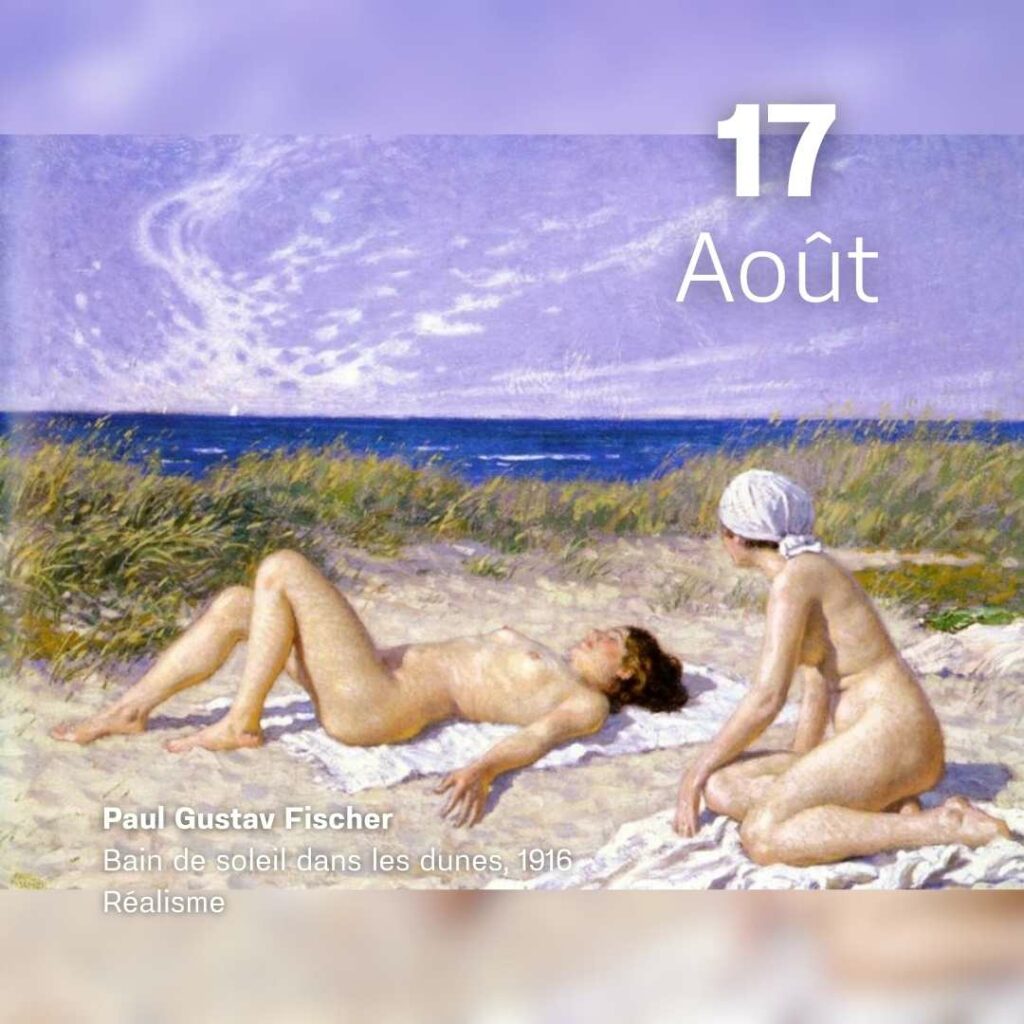Le 20 mars 1852 paraît en volume « La Case de l’oncle Tom » (Uncle Tom’s Cabin), un roman de l’écrivaine américaine Harriet Beecher Stowe, après avoir été publié sous forme de feuilleton dans le journal abolitionniste « The National Era » à partir du 5 juin 1851.
« La Case de l’oncle Tom » est un roman antiesclavagiste qui dépeint la réalité de l’esclavage tout en affirmant que l’amour chrétien peut surmonter cette épreuve destructrice. Publié en deux volumes, ce livre a un impact profond sur l’état d’esprit général vis-à-vis des Afro-Américains et de l’esclavage aux États-Unis, devenant un facteur d’exacerbation des tensions qui mènent à la Guerre de Sécession. Dès sa publication, le roman connaît un succès immédiat avec 3 000 exemplaires vendus le jour même. Il devient le roman le plus vendu du XIXe siècle et le deuxième livre le plus vendu après la Bible, avec 300 000 exemplaires écoulés aux États-Unis durant la première année.

Harriet Elisabeth Beecher Stowe est une auteure et abolitionniste américaine née le 14 juin 1811 à Litchfield, Connecticut. Issue d’une famille remarquable, elle est la septième enfant du révérend Lyman Beecher, un éminent ministre congrégationaliste. Sa carrière d’écrivaine s’étend sur 51 ans, durant lesquels elle publie 30 livres et d’innombrables nouvelles, poèmes, articles et hymnes. Deux événements majeurs la poussent à écrire « La Case de l’oncle Tom » : la perte de son fils Samuel Charles, âgé de 18 mois, mort du choléra en 1849, qui lui permet de comprendre la douleur des mères esclaves dont les enfants sont vendus loin d’elles, et son indignation face à la loi sur les esclaves fugitifs de 1850.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
La loi sur les esclaves fugitifs (Fugitive Slave Act) est adoptée par le Congrès des États-Unis le 18 septembre 1850 dans le cadre du Compromis de 1850. Cette loi controversée oblige tous les citoyens à aider à capturer les esclaves en fuite et crée des sanctions pour ceux qui refusent. Elle permet à quiconque d’être accusé d’être un esclave fugitif et d’être amené devant un commissaire financièrement incité à renvoyer les accusés en esclavage. Les commissaires reçoivent 10 dollars s’ils décident qu’une personne est un esclave fugitif, mais seulement 5 dollars s’ils la déclarent libre. Toute personne aidant un fugitif est passible de six mois d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars. Cette loi exacerbe les tensions entre le Nord et le Sud, contribuant à la polarisation du pays sur la question de l’esclavage.
« La Case de l’oncle Tom » raconte l’histoire d’esclaves noirs dans l’Amérique du XIXe siècle, principalement centrée sur le personnage de Tom, un esclave chrétien au caractère généreux et à la foi inébranlable. L’histoire débute dans le Kentucky, où M. Shelby, un propriétaire terrien endetté, se voit contraint de vendre deux de ses esclaves : l’oncle Tom et Henri, le jeune fils d’Elisa. Tom est vendu à un marchand qui l’emmène sur un bateau descendant le Mississippi, où il rencontre Eva, une jeune fille blanche qu’il sauve de la noyade. Le père d’Eva, Augustine St. Clare, achète Tom par reconnaissance. Après la mort d’Eva puis celle de St. Clare, Tom est vendu à Simon Legree, un propriétaire cruel qui le fait battre à mort pour avoir refusé de dénoncer des esclaves en fuite. Parallèlement, Elisa s’enfuit avec son fils et retrouve son mari Georges Harris, et ensemble ils tentent de gagner le Canada.
Harriet Beecher Stowe est une fervente abolitionniste qui utilise sa plume pour lutter contre l’esclavage. Elle et son mari sont des soutiens du « chemin de fer souterrain » et hébergent des esclaves fugitifs dans leur maison alors qu’ils s’échappent vers le nord. Malgré son opposition à l’esclavage, ses positions sur la question raciale sont complexes et évoluent au fil du temps. Initialement, elle soutient l’idée d’envoyer les Noirs libérés au Libéria en Afrique. Dans ses lettres, elle montre qu’elle ne croit pas à l’égalité raciale et utilise parfois un langage péjoratif pour décrire les serviteurs noirs. Malgré ces contradictions, son œuvre joue un rôle crucial dans la sensibilisation du public américain aux horreurs de l’esclavage, au point que le président Lincoln aurait dit en la rencontrant : « C’est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre ».