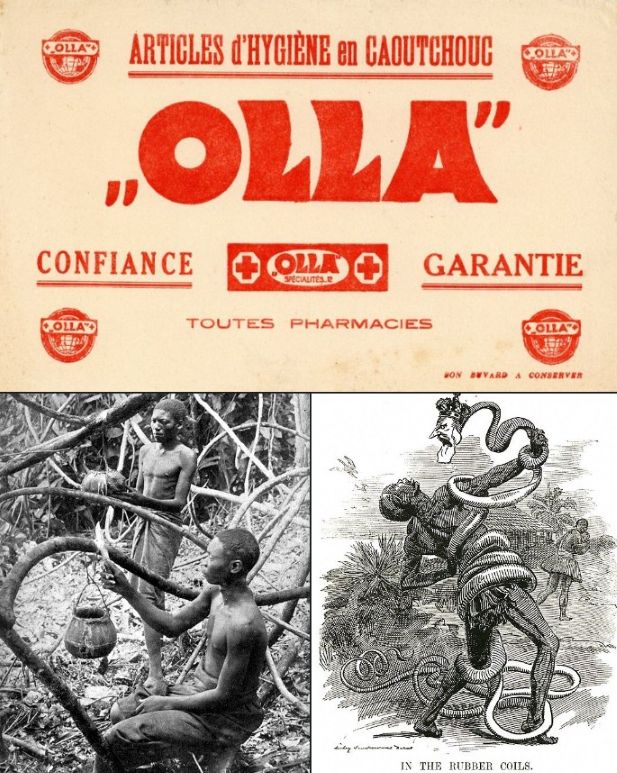La mort de Hu Yaobang, ancien secrétaire général du Parti communiste chinois et symbole de réformes, déclenche les manifestations de Tian’anmen. Dès l’annonce de son décès le 15 avril 1989, des étudiants et des intellectuels se rassemblent spontanément sur la place Tian’anmen pour lui rendre hommage et exprimer leur mécontentement face à la corruption et au manque de réformes politiques.
Le mouvement se met en place en parallèle des funérailles de Hu Yaobang. Les premiers jours, les étudiants organisent des veillées, des marches silencieuses et rédigent des pétitions. Le 22 avril, jour des funérailles, des dizaines de milliers de personnes se réunissent sur la place, transformant l’hommage en manifestation politique. Les étudiants profitent de la solennité de l’événement pour remettre publiquement leurs revendications au gouvernement. Progressivement, des comités étudiants se forment pour coordonner les actions, la logistique et la communication, et la contestation s’étend à d’autres universités et villes du pays.
Hu Yaobang est un homme politique chinois, secrétaire général du Parti communiste de 1980 à 1987. Après la mort de Mao, il participe activement à la modernisation de la Chine, encourageant la réhabilitation des victimes de la Révolution culturelle, la libéralisation de la pensée et la promotion des intellectuels. Il soutient des réformes politiques et économiques sous l’impulsion de Deng Xiaoping, mais son ouverture lui vaut l’hostilité des conservateurs. Il est contraint à la démission en 1987 après des manifestations étudiantes, mais reste membre du Politburo. Il meurt le 15 avril 1989 à Pékin, des suites d’une crise cardiaque, événement qui sert de catalyseur aux manifestations.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Deng Xiaoping, né en 1904, devient le dirigeant le plus puissant de Chine à la fin des années 1970. Il lance les grandes réformes économiques, introduit des éléments d’économie de marché, ouvre la Chine aux investissements étrangers et encourage la modernisation de l’agriculture, de l’industrie, de la défense et de la science. Il met en place la politique de l’enfant unique et favorise la montée d’une nouvelle génération de cadres. Cependant, il refuse toute ouverture politique réelle et maintient le contrôle strict du Parti communiste, n’hésitant pas à recourir à la force pour préserver la stabilité du régime, comme lors de Tian’anmen.
Durant les premiers jours, les manifestants s’organisent de façon spontanée. Les étudiants de différentes universités se rassemblent sur la place, rédigent des pétitions, organisent des veillées et des débats publics. Des comités étudiants se forment progressivement pour coordonner les actions, gérer la logistique et désigner des porte-parole. L’absence de direction centralisée rend la coordination complexe, mais témoigne de la vitalité du mouvement. Les manifestants installent des campements, organisent des tours de garde et des distributions de nourriture, et tiennent des assemblées générales pour débattre des actions à mener.
Au début, le mouvement se montre respectueux du gouvernement. Lorsque des individus dégradent le portrait de Mao Zedong sur la place, ce sont les étudiants eux-mêmes qui les arrêtent, les interrogent et les remettent à la police. Les leaders étudiants condamnent publiquement cet acte, insistent sur le fait qu’il ne représente pas l’esprit du mouvement et affichent leur volonté de rester dans un cadre légal et respectueux des symboles de l’État. Ils cherchent ainsi à prouver qu’ils ne sont pas des « contre-révolutionnaires » mais des citoyens responsables réclamant des réformes.
Le mouvement se répand rapidement dans tout le pays. La couverture médiatique et le bouche-à-oreille permettent aux informations de circuler, inspirant des étudiants et des travailleurs dans de nombreuses villes à organiser leurs propres rassemblements. Des grèves de la faim, des marches et des manifestations de soutien se multiplient dans plus de 400 villes. Le mouvement s’élargit à d’autres catégories sociales, et reçoit un écho international, notamment à Hong Kong et dans la diaspora chinoise.
La confrontation entre manifestants et gouvernement s’enfonce dans la durée à partir de la mi-mai. Le gouvernement proclame la loi martiale, mais les convois militaires sont bloqués par la population. Les positions se durcissent : les autorités refusent de négocier, les étudiants, soutenus par la population, refusent de quitter la place. L’absence de compromis, la fragmentation du leadership étudiant et la radicalisation des autorités prolongent l’impasse. Fin mai, l’armée reçoit l’ordre d’intervenir. Dans la nuit du 3 au 4 juin, l’armée ouvre le feu sur les manifestants, mettant brutalement fin au mouvement après plusieurs semaines de mobilisation.
Photo: © Stuart Franklin / Magnum Photos