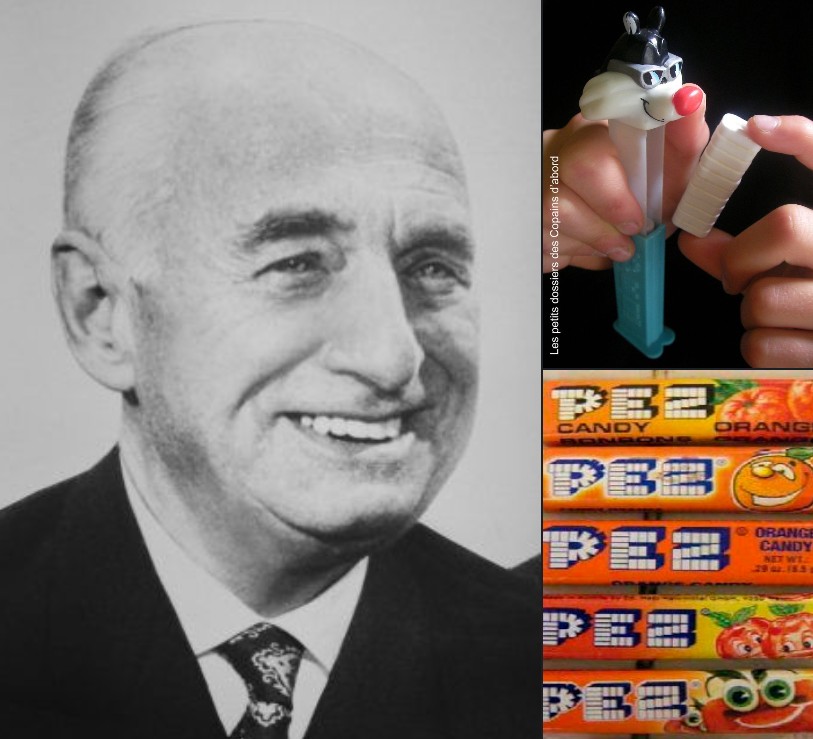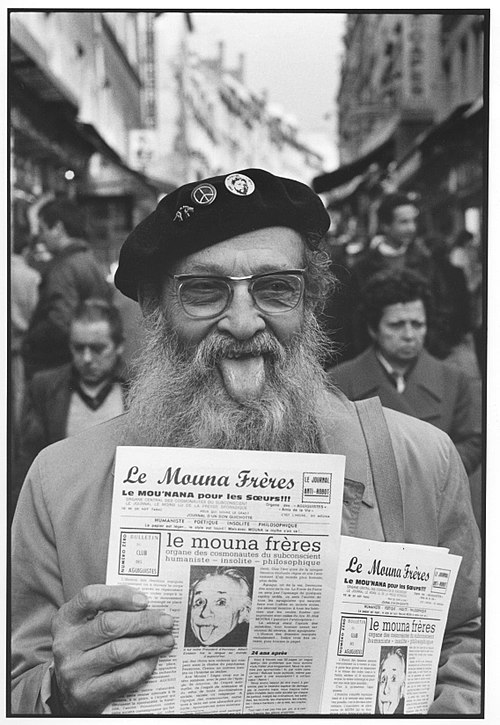Le 23 avril 1616, Miguel de Cervantes est enterré à Madrid. Celui que l’on considère aujourd’hui comme le père du roman moderne s’éteint dans la discrétion, après une vie d’aventures, de luttes et de génie littéraire. Ce jour-là, l’Espagne perd l’un de ses plus grands écrivains.
Miguel de Cervantes naît en 1547 dans une famille modeste d’Alcalá de Henares. Très tôt, il se passionne pour les lettres et le théâtre, mais c’est la guerre qui le mène sur les routes du monde. En 1571, il s’engage dans la marine espagnole et participe à la bataille de Lépante, où il se distingue par son courage. Grièvement blessé, il perd l’usage de sa main gauche, ce qui lui vaudra le surnom de « Manchot de Lépante ». Mais l’aventure ne s’arrête pas là : en 1575, alors qu’il rentre en Espagne, il est capturé par des corsaires barbaresques et emmené à Alger.
La captivité de Cervantes à Alger dure cinq longues années. Il tente à quatre reprises de s’évader, risquant sa vie à chaque fois. Sa première tentative échoue lorsqu’un complice les abandonne dès le premier jour de fuite, forçant Cervantes et ses compagnons à rentrer à Alger où ils subissent de lourdes représailles. Sa deuxième tentative, en 1577, consiste à cacher quatorze compagnons dans une grotte, espérant l’arrivée d’un navire espagnol : ils sont trahis et capturés, mais Cervantes assume toute la responsabilité, protégeant ainsi ses amis. Lors de la troisième tentative, il cherche à contacter Oran pour organiser une évasion, mais le messager est intercepté, ce qui lui vaut d’être dénoncé et condamné à une peine qui sera finalement annulée. Sa quatrième et dernière tentative, la plus ambitieuse, prévoit l’achat d’une frégate pour libérer une soixantaine de captifs : le plan est trahi par un autre prisonnier, et Cervantes est de nouveau emprisonné, attendant d’être envoyé à Constantinople. Sa ténacité et son courage impressionnent même ses geôliers.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Libéré en 1580 grâce à une rançon réunie par sa famille et des religieux, Cervantes rentre en Espagne. Il retrouve une existence instable, où il enchaîne les emplois administratifs : commissaire aux vivres pour l’Armada, collecteur d’impôts, missions ponctuelles pour la couronne. Ces fonctions le conduisent à travers l’Andalousie et la Castille, mais lui apportent surtout des ennuis : il est accusé de malversations, connaît la prison et vit souvent dans la précarité. Son mariage avec Catalina de Salazar ne lui apporte pas la stabilité espérée, et il doit subvenir aux besoins de sa famille élargie.
Malgré les difficultés, Cervantes ne cesse jamais d’écrire. Il publie La Galatée en 1585, compose des pièces de théâtre et rédige de nombreux poèmes. Mais c’est en 1605 que sa vie bascule : la première partie de Don Quichotte paraît à Madrid et rencontre un succès foudroyant. Le roman s’arrache, circule dans toute l’Europe, est rapidement traduit et connaît de multiples éditions. Pourtant, la gloire littéraire ne s’accompagne pas de richesse : les droits d’auteur n’existent pas, et Cervantes doit continuer à travailler pour vivre.
Jusqu’à sa mort, Cervantes poursuit son œuvre, publiant la seconde partie de Don Quichotte en 1615, ainsi que des nouvelles et des romans. Il s’impose comme une figure majeure de la littérature espagnole, admiré pour son humour, sa lucidité et son humanité. Son parcours, fait d’épreuves et de résilience, nourrit ses personnages et donne à son œuvre une profondeur unique.
Le 23 avril 1616, Cervantes s’éteint, laissant derrière lui un héritage littéraire inestimable. Ironie du sort, ce même jour, de l’autre côté de la Manche, William Shakespeare, l’autre géant des lettres européennes, disparaît à son tour. Deux destins exceptionnels s’achèvent, mais leurs œuvres continuent de traverser les siècles, immortelles.
Illustration: Don Quichotte et Rossinante, Honoré Daumier (vers 1868). – Wikipédia