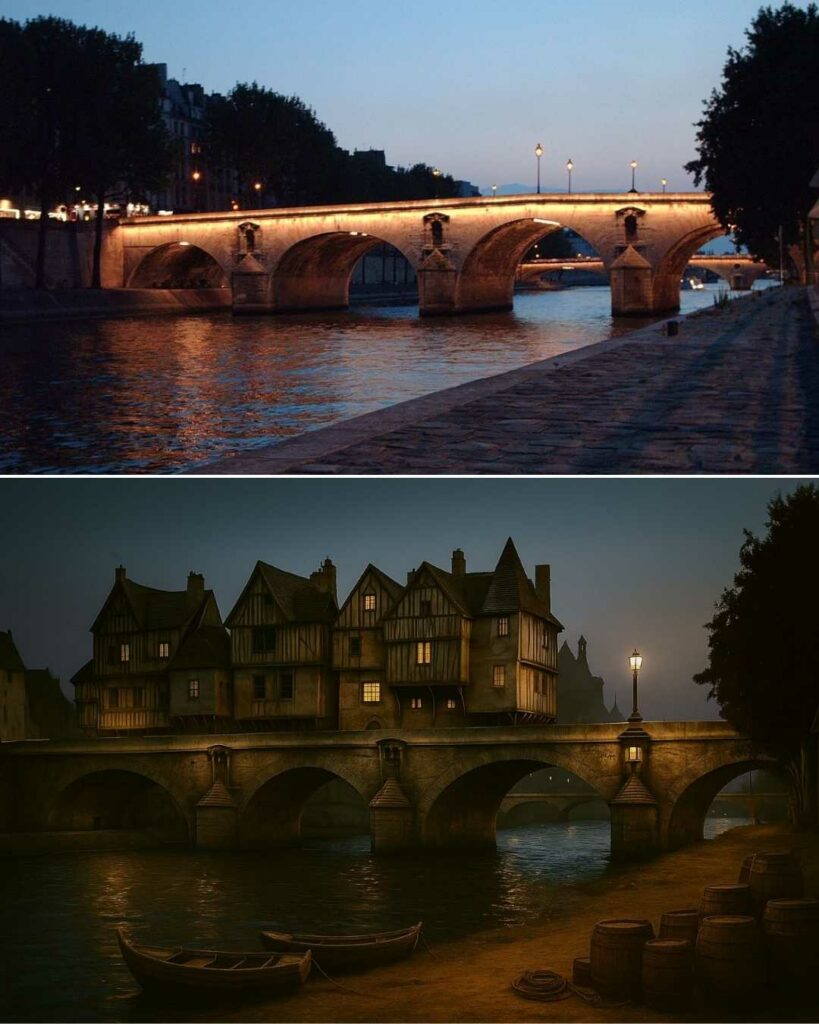Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, à Constantinople, la capitale de l’Empire ottoman, la vie bascule pour des centaines de familles arméniennes. La police ottomane, agissant sur ordre du gouvernement Jeunes-Turcs, arrête méthodiquement plus de deux cents intellectuels, ecclésiastiques, médecins, avocats, journalistes, enseignants, artistes et hommes politiques arméniens.
Suite à la rafle des intellectuels arméniens, aussi appelée le « dimanche rouge », 235 à 270 femmes et hommes, figures centrales de la communauté, sont d’abord détenus, puis déportés vers l’intérieur de l’Empire. La plupart ne revoient jamais leur foyer. L’opération se poursuit dans les jours suivants, portant le nombre total de notables arrêtés à environ 2 345 à Constantinople. Cette nuit du 24 marque le début du génocide arménien et la volonté délibérée d’anéantir un peuple en décapitant son élite.
À cette époque, l’Empire ottoman traverse une période de profond déclin. Jadis vaste et puissant, il se réduit désormais à l’Anatolie, à une partie du Moyen-Orient et à quelques territoires européens résiduels. Les guerres balkaniques, l’ingérence des puissances étrangères et la montée des nationalismes minent son autorité et sa cohésion. Sa population, autrefois mosaïque, se fragilise, et les tensions ethniques et religieuses s’exacerbent. Les Arméniens, l’une des principales minorités chrétiennes de l’Empire, vivent principalement en Anatolie orientale, à Constantinople et dans d’autres grandes villes. Ils jouent un rôle actif dans la vie économique, culturelle et politique, tout en subissant les discriminations liées à leur statut de non-musulmans.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
La communauté arménienne, attachée à l’Empire malgré les difficultés, fait preuve de loyauté et de prudence à la veille de la Première Guerre mondiale. Ses dirigeants appellent au calme et à la patience, espérant éviter toute provocation qui pourrait servir de prétexte à des violences. Les Arméniens servent dans l’armée ottomane, participent à la vie publique et s’efforcent de préserver l’harmonie dans un contexte de plus en plus tendu. Pourtant, ils deviennent la cible de la suspicion et du ressentiment des autorités Jeunes-Turcs, qui voient en eux une menace intérieure, potentiellement alliée de la Russie chrétienne voisine.
Les Jeunes-Turcs, mouvement nationaliste et modernisateur, prennent le pouvoir au début du XXe siècle avec l’ambition de transformer l’Empire en un État-nation turc homogène. Leur idéologie, fondée sur le nationalisme et l’islam, exclut les minorités non musulmanes du projet national. Lorsque la guerre éclate en 1914, la peur de la trahison et la volonté de « turquiser » l’Anatolie se conjuguent pour faire des Arméniens les boucs émissaires d’un Empire en crise. Les accusations de rébellion, souvent infondées, servent de justification à une politique d’extermination planifiée.
Après la rafle des élites, le génocide s’organise en plusieurs phases. Les hommes sont séparés de leurs familles et exécutés. Femmes, enfants et personnes âgées sont déportés par centaines de milliers vers le désert syrien, dans des convois où la faim, la soif, la maladie et les violences font des ravages. Les survivants de ces marches de la mort sont parqués dans des camps à Deir ez-Zor et ailleurs, où de nouveaux massacres achèvent l’œuvre de destruction. Les biens arméniens sont confisqués, les villages vidés de leurs habitants, et la culture arménienne tente d’être effacée de la mémoire de l’Empire.
Au total, entre 1,2 et 1,5 million d’Arméniens périssent, soit les deux tiers de la population arménienne de l’Empire ottoman. Les survivants, brisés, trouvent refuge dans la diaspora ou restent cachés, souvent assimilés de force. Ce crime, l’un des premiers génocides du XXe siècle, laisse une blessure profonde dans la mémoire collective arménienne et dans l’histoire de l’humanité.
Aujourd’hui, la reconnaissance du génocide arménien progresse, mais demeure incomplète. Près de trente pays, dont la France, l’Allemagne, la Russie, le Canada et les États-Unis, reconnaissent officiellement le génocide. L’Union européenne et plusieurs organisations internationales appellent la Turquie, héritière de l’empire Ottoman, à faire de même. Pourtant, Ankara continue de nier le terme de génocide, préférant parler de « tragédies partagées » et de « guerre civile ». Ce refus, partagé par quelques alliés stratégiques, entretient la douleur des descendants et complique la réconciliation. Pour les Arméniens du monde entier, la reconnaissance reste un enjeu de justice, de mémoire et de prévention des crimes contre l’humanité.
Le 24 avril, chaque année, la voix des survivants et de leurs descendants rappelle au monde que la mémoire est un acte de résistance face à l’oubli et au déni.
Photo: Les forces militaires ottomanes conduisent des hommes arméniens vers un lieu d’exécution en dehors de la ville de Kharpout. Kharpout, Empire ottoman, mars-juin 1915. – Encyclopédie Multimédia de la Shoah