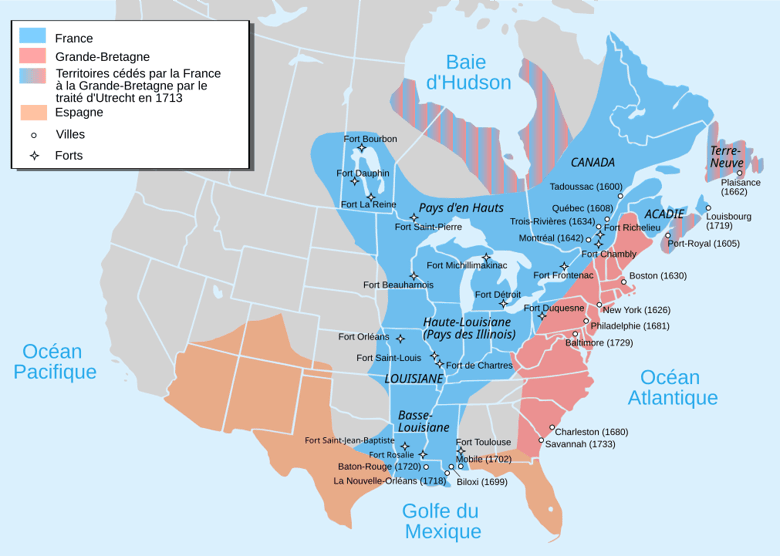Le 17 juillet 1793, la tension est à son comble sur la place de la Révolution à Paris. Très tôt dans la matinée, une jeune femme monte les marches de l’échafaud, vêtue de la chemise rouge infamante réservée aux assassins : il s’agit de Charlotte Corday, à peine vingt-cinq ans, connue désormais de tous pour le meurtre de Jean-Paul Marat.
Sommaire
Un crime qui questionne
Sa démarche digne, son visage serein malgré l’effervescence populaire, frappent jusqu’aux plus blasés des témoins. Son geste et son calme bouleversent l’opinion : comment une femme jeune, instruite, issue d’un milieu respectable, a-t-elle pu concevoir et mener à bien l’assassinat d’un homme du peuple devenu idole de la Révolution ?
Plus encore, la société tout entière et les révolutionnaires eux-mêmes s’interrogent : le crime de Charlotte Corday relève-t-il d’une impulsion passionnelle, d’un égarement irrationnel propre à sa condition de femme ? Ou bien faut-il accepter, au risque de tout remettre en question, qu’une jeune femme parfaitement « équilibrée », indépendante d’esprit et de cœur, soit capable de justifier une action aussi radicale au nom d’une réflexion politique cohérente ?
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Un acte mûrit ?
Charlotte Corday n’est pas une égarée prise dans les tourments de la passion ou de la vengeance. Née dans une famille aristocratique appauvrie de Normandie, elle reçoit une solide éducation religieuse et intellectuelle au couvent, où elle découvre la philosophie des Lumières et forge très tôt son attachement aux valeurs de justice et de liberté. Persuadée que l’idée républicaine annonce un monde meilleur, elle se montre d’abord enthousiaste quant aux bouleversements révolutionnaires de 1789.
Cependant, le spectacle croissant des violences, les premières exécutions arbitraires, puis la mise au ban des Girondins qu’elle admire pour leur modération, achèvent de la convaincre que la Révolution s’égare — dévorée par ses extrêmes. Sa décision de tuer Marat, loin d’être improvisée ou dictée par l’émotion, mûrit au fil des semaines dans une conscience aiguë des enjeux politiques : il ne s’agit pas, à ses yeux, de punir un homme, mais de sacrifier un personnage dangereux pour délivrer la France du chaos. En cela, son geste relève d’un calcul rationnel : elle croit agir pour sauver des milliers de vies, en sacrifiant « un homme nuisible ». Face à ses juges, elle assume : « J’ai tué un homme pour en sauver cent mille. »
Un acte préparé ?
Charlotte Corday prépare son geste avec une détermination implacable. Convaincue que Marat symbolise le mal dont souffre la Révolution, elle quitte Caen pour Paris avec un dessein précis. Pendant plusieurs jours, elle tente, sans succès, d’approcher celui qu’elle considère comme l’« ennemi du peuple », prétextant vouloir lui remettre une liste de traîtres girondins.
Le 13 juillet 1793, profitant de l’état de santé fragile de Marat, obligé de recevoir dans sa baignoire en raison de sa maladie de peau, Corday parvient à être introduite dans son appartement. Elle engage une conversation, répond à ses questions, puis, au moment le plus inattendu, sort un couteau dissimulé et frappe Marat en pleine poitrine. Celui-ci meurt rapidement, sous les yeux de sa compagne terrifiée.


Charlotte Corday ne tente pas de s’enfuir, elle est aussitôt arrêtée. Son attitude calme sidère les témoins ; elle revendique son acte comme un service rendu à la France, sans haine personnelle, mais avec la conviction profonde qu’elle accomplit un devoir nécessaire pour le salut public.
Une victime innocente ?
La figure de Jean-Paul Marat que vise Charlotte Corday concentre à elle seule toutes les tensions de l’époque. Médecin, écrivain, et journaliste inlassable, Marat s’est imposé avec son journal L’Ami du peuple comme la voix des couches populaires parisiennes les plus radicales. Dénonçant sans relâche complots, modérés ou ennemis supposés de la Révolution, il revendique une justice sans merci, érigeant l’élimination physique en instrument de salut public.
Sa parole, reprise dans les quartiers populaires de Paris, devient rapidement le credo des sans-culottes, excédés par la misère et hostiles à toute demi-mesure. Marat fait partie des Montagnards, ces députés qui prônent la centralisation du pouvoir, la surveillance généralisée et la Terreur comme outils politiques nécessaires.
Pour Corday, Marat n’incarne plus l’espoir de liberté : il cristallise au contraire la déraison révolutionnaire, la haine de classe et la violence institutionnalisée. Le supprimer, ce n’est pas abattre un homme, mais tenter de rompre avec la spirale de sang qui emporte la Révolution vers l’abîme.
Le procès d’une femme ou d’une idée ?
Après son arrestation, Charlotte Corday étonne ses geôliers par la fermeté de ses convictions et la sérénité de son attitude. Dès l’ouverture du procès devant le Tribunal révolutionnaire, la jeune femme refuse toute défense traditionnelle et revendique la pleine responsabilité de son acte, insistant sur la dimension politique et réfléchie de son geste.

Or, la société de l’époque peine à admettre qu’une femme, jeune et cultivée, puisse si parfaitement dominer ses nerfs et son destin sans l’intervention d’une main masculine. Les autorités révolutionnaires cherchent à diluer la portée de l’acte en évoquant l’hypothèse d’un crime passionnel : la presse s’empresse de spéculer sur la vie privée de Corday, d’imaginer un mystérieux complice ou le rôle d’un prétendu amant. Jusqu’au bout, les médecins vont même jusqu’à pratiquer une autopsie et à consigner, dans un rapport public, la virginité de l’accusée : il s’agit de prouver, ou de démentir, que son engagement serait autre chose qu’une manipulation affective ou sexuelle.
Cette méfiance à l’égard de l’autonomie politique des femmes en dit long sur les mentalités révolutionnaires : tout dans l’institution cherche à reléguer Charlotte Corday au rang de femme égarée, alors qu’elle incarne une citoyenne pleinement responsable.
Un acte salutaire ?
Le meurtre de Marat ne produit pas l’apaisement espéré par Corday : il marque au contraire une radicalisation irréversible des tensions révolutionnaires. Les Montagnards, appuyés par la ferveur populaire, font du défunt un martyr et instrumentalisent sa mort pour justifier la Terreur. La mémoire de Charlotte Corday, deux siècles plus tard, demeure profondément divisée : pour certains, elle est l’incarnation du courage face à l’oppression ; pour d’autres, celle d’une dangereuse fanatique. Une fanatique parmi d’autres fanatiques, soit dit en passant.
Face à cette histoire, on peut aussi se demander pourquoi et comment une société peut avoir tant de mal à accepter l’idée que la réflexion politique, la lucidité et le sens du devoir puissent appartenir à une jeune femme aussi aisément qu’à un homme. Charlotte Corday a choisi, en toute conscience, la violence pour répondre à une violence encore plus grande, avec pour conséquence une intensification du chaos et un héritage politique fracturé empreint de dilemmes irrésolus. Voilà qui pourrait répondre à cette dernière question si tellement d’hommes n’avaient pas aussi choisi cette voix en toute connaissance de cause.
Illustration:
– Charlotte Corday conduite à la guillotine par Arturo Michelena (1889). – Wikipédia
– Lithographie de 1823 colorisée au XXe siècle. – Wikipédia
– Portrait de Jean-Paul Marat par Joseph Boze. – Wikipédia