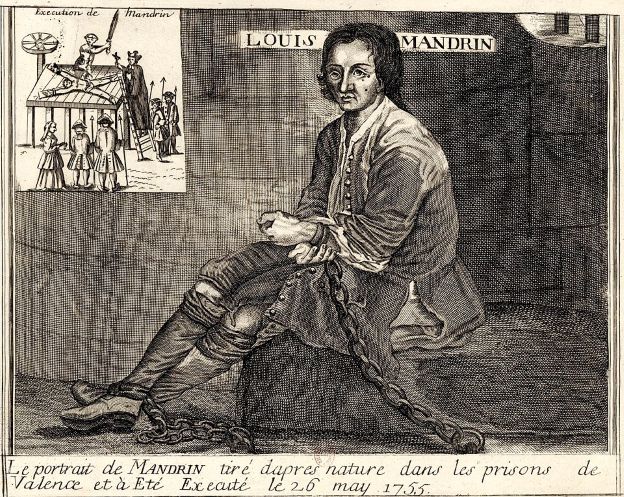Le 30 juillet 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche bientôt à sa fin, le croiseur lourd américain USS Indianapolis joue un rôle crucial en livrant des composants essentiels destinés aux premières bombes atomiques vers l’île de Tinian. Cette mission secrète menée à bien dans la plus grande discrétion se transforme rapidement en catastrophe lors du retour vers Leyte. Sans escorte, l’Indianapolis est surpris dans la mer des Philippines par un sous-marin japonais qui parvient à le torpiller.
Sommaire
Un croiseur isolé face à un danger sous-estimé
L’USS Indianapolis navigue seul, exposé à une vulnérabilité extrême. Le commandant du navire avait pourtant insisté pour bénéficier d’une escorte, conscient du risque. Mais les autorités navales, convaincues que la zone était sécurisée en cette fin de conflit et pressées par l’urgence de la mission, refusent cette demande. Ce choix se révèle désastreux.

Dans la nuit du 29 au 30 juillet, deux torpilles tirées par le sous-marin I-58 frappent violemment la coque du navire, provoquant des explosions dévastatrices. Le croiseur coule à une vitesse alarmante, en moins de douze minutes, engloutissant avec lui environ 300 membres d’équipage, piégés dans les compartiments submergés.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
L’enfer à la dérive : la lutte pour la survie
Les dégâts physiques du naufrage ne sont que le prélude à une épreuve encore plus terrible. Environ 900 marins échappent à la mort immédiate, mais ils dérivent dans l’immensité de la mer, souvent sans canots ni équipement adéquat. Les conditions sont extrêmes : la soif tenaille, le soleil écrasant le jour, le froid mordant la nuit, et surtout, la peur omniprésente des attaques de requins affamés. Ces derniers sont irrésistiblement attirés par le sang, les mouvements frénétiques et l’odeur humaine.
De surcroît, beaucoup de marins, pris par la déshydratation, boivent de l’eau de mer, aggravant leur état. Il faut savoir que la forte concentration en sel de l’eau de mer force le corps à utiliser sa propre eau pour éliminer cet excès, ce qui intensifie la déshydratation. Au lieu d’étancher leur soif, les marins connaissent diarrhées, vomissements et troubles graves comme des hallucinations ou une insuffisance rénale conduisant rapidement à la mort cellulaire et au décès.
Chaque instant devient alors une bataille contre la mort.
Les attaques incessantes des requins
Les requins présents dans cette région – principalement les requins longimanes et les requins-tigres – se nourrissent d’abord des corps flottants, mais se tournent rapidement vers les vivants, fascinés par l’agitation et le sang. Les survivants tentent désespérément de se rassembler en groupe pour se protéger, formant parfois des cercles serrés, car les individus isolés sont les premières victimes.
Malgré ces efforts, la panique, la fatigue et les blessures dispersent peu à peu les marins. Les attaques sont soudaines et violentes, causant de nombreuses pertes. On estime que plusieurs dizaines à plus d’une centaine d’hommes succombent ainsi, tandis que d’autres meurent d’épuisement, d’exposition ou de blessures non soignées.

Des secours dus au hasard
Le naufrage aurait pu rester complètement ignoré, car personne ne signale la disparition de l’Indianapolis dans l’immédiat. En raison de la mission secrète et d’erreurs administratives, le navire n’est pas déclaré manquant. Aucune opération de recherche ne démarre, et plusieurs erreurs humaines empêchent la réaction rapide.
Le silence se brise seulement quatre jours plus tard, avec un incroyable coup de chance : un avion de patrouille américain aperçoit une nappe d’huile à la surface de la mer. En s’approchant, le pilote découvre des survivants flottant faiblement, lance un appel de détresse et largue du matériel de secours. Un hydravion Catalina est aussitôt envoyé sur place et commence à repêcher des survivants, parfois même en enfreignant les ordres (le pilote amerrit dans une mer agitée pleine de requins pour pouvoir embarquer le plus de naufragés possible). Très vite, des navires de surface, dont le destroyer USS Cecil J. Doyle, convergent également vers la scène du drame.
Cependant, malgré ces efforts héroïques, seuls 317 hommes sur environ 1 200 survivent à cette terrible odyssée.
L’épave enfin retrouvée
L’épave de l’USS Indianapolis est retrouvée en août 2017, après plus de 72 ans d’attente et de nombreuses tentatives infructueuses par des chercheurs et passionnés du monde entier. Cette prouesse scientifique et humaine est portée par le milliardaire américain Paul Allen, cofondateur de Microsoft et passionné d’histoire navale. Son équipe, à bord du navire de recherche R/V Petrel, localise le croiseur à plus de 5 500 mètres de profondeur dans la mer des Philippines.
La tâche est titanesque, la zone de disparition couvrant plus de 1 500 km². Ce n’est qu’en 2016, grâce à la découverte de nouveaux documents historiques par l’historien de la Navy, Richard Hulver, précisant la position d’un autre navire ayant croisé l’Indianapolis onze heures avant son naufrage, que l’équipe peut cibler un secteur plausible. En combinant ces données à la technologie de pointe du R/V Petrel et à des drones sous-marins capables d’atteindre 6 000 m de profondeur, la localisation précise devient possible.
Sur les images ramenées à la surface, on distingue nettement le numéro 35 peint sur la coque du croiseur, pièce maîtresse de la confirmation visuelle. L’état de conservation du navire est remarquable : l’obscurité, l’absence de courants violents et la pression des grands fonds contribuent à préserver le site, intact et silencieux, dans son linceul d’acier.

Illustration: Image générée par IA
Apporte ta contribution sur les réseaux