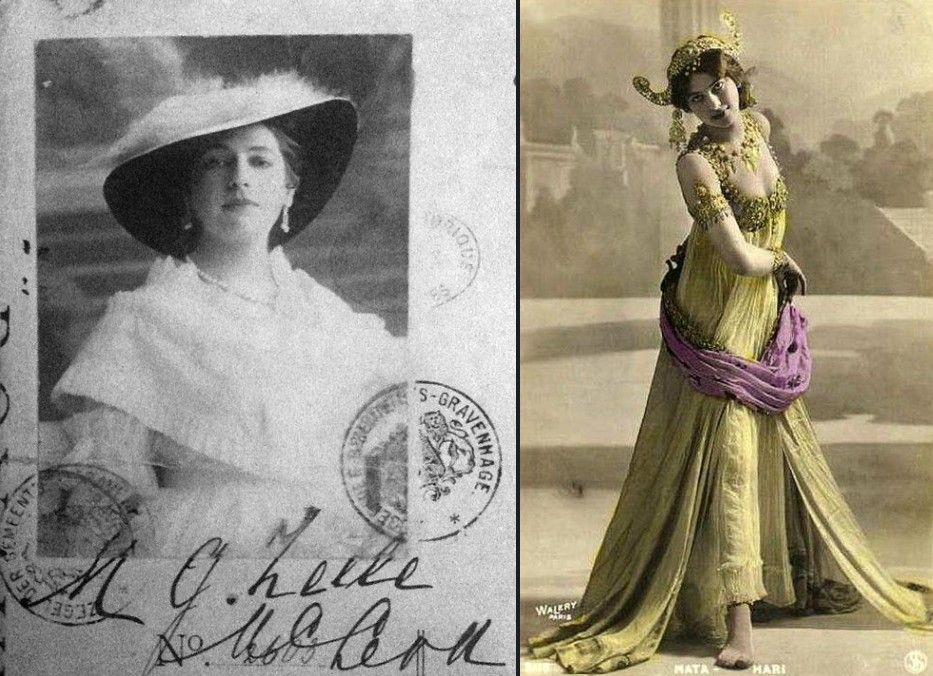Le 4 août 1914, l’Allemagne met en œuvre le plan Schlieffen reposant sur une attaque massive du nord de la France en passant par la Belgique, pourtant pays neutre, avant que la Russie à l’est n’ait le temps de mobiliser. Ce plan comporte une faille : il ne prend pas en compte la résistance héroïque de la Belgique.
Alors que la guerre, déclarée par l’Allemagne à la France et à la Russie, éclate en Europe, la position géographique stratégique de la Belgique la place au cœur du conflit, malgré sa volonté de rester en dehors des hostilités. Elle se trouve malgré elle prise en étau entre deux grands blocs rivaux en 1914 : la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et la Triple Alliance, formée par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie (avant que celle-ci ne change de camp en 1915).
Dès le 2 août 1914, sans déclaration de guerre, l’Allemagne envahit le Luxembourg. À 19 heures, Julien Davignon, le ministre belge des Affaires Étrangères, reçoit l’ultimatum suivant :
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Le Gouvernement allemand a reçu des nouvelles sûres, d’après lesquelles les forces françaises auraient l’intention de marcher sur la Meuse par Givet et Namur ; ces nouvelles ne laissent aucun doute sur l’intention de la France de marcher sur l’Allemagne par le territoire belge. Le Gouvernement impérial allemand ne peut s’empêcher de craindre que la Belgique, malgré sa meilleure volonté, ne soit pas en mesure de repousser avec succès une marche française comportant un plan aussi étendu, de façon à assurer à l’Allemagne une sécurité suffisante contre cette menace ; c’est un devoir impérieux de conservation pour l’Allemagne de prévenir cette attaque de l’ennemi.
Le Gouvernement allemand regretterait très vivement que la Belgique regardât comme un acte d’hostilité contre elle le fait que les mesures des ennemis de l’Allemagne l’obligent à violer aussi, de son côté, le territoire belge. Afin de dissiper tout malentendu, le Gouvernement allemand déclare ce qui suit :
1° L’Allemagne n’a en vue aucun acte d’hostilité contre la Belgique. Si la Belgique consent, dans la guerre qui va commencer, à prendre une attitude de neutralité amicale vis-à-vis de l’Allemagne, le Gouvernement allemand, de son côté, s’engage, au moment de la paix, à garantir l’intégrité et l’indépendance du royaume dans toute leur ampleur.
2° L’Allemagne s’engage, sous la condition énoncée, à évacuer le territoire belge aussitôt la paix conclue.
3° Si la Belgique observe une attitude amicale, l’Allemagne est prête, d’accord avec les autorités du Gouvernement belge, à acheter contre argent comptant tout ce qui est nécessaire à ses troupes et à l’indemniser pour les dommages quelconques causés en Belgique par les troupes allemandes.
4° Si la Belgique se comporte d’une façon hostile contre les troupes allemandes et particulièrement fait des difficultés à leur marche en avant par la résistance des fortifications de la Meuse ou par des destructions de routes, chemins de fer, tunnels on autres ouvrages d’art, l’Allemagne sera obligée, à regret, de considérer la Belgique en ennemie.
Dans ce cas, l’Allemagne ne pourrait prendre aucun engagement vis-à-vis du royaume, mais elle devrait laisser le règlement ultérieur des rapports des deux États l’un vis-à-vis de l’autre à la décision des armes.
Le Gouvernement a le ferme espoir que cette éventualité ne se produira pas et que le Gouvernement belge saura prendre les mesures appropriées pour empêcher que des faits comme ceux qui viennent d’être mentionnés ne se produisent. Dans ce cas, les relations d’amitié qui unissent les deux États voisins seront maintenues d’une façon durable.
À la réception de la missive, le roi Albert Ier convoque un conseil de crise et le 3 août à 7 heures du matin rejette l’ultimatum en tenant ce discours :
[…] Aucun intérêt stratégique ne justifie la violation du droit. Le Gouvernement belge, en acceptant les propositions qui lui sont notifiées, sacrifierait l’honneur de la nation, en même temps qu’il trahirait ses devoirs vis-à-vis de l’Europe. Conscient du rôle que la Belgique joue depuis plus de quatre-vingts ans dans la civilisation du monde, il se refuse à croire que l’indépendance de la Belgique ne puisse être conservée qu’au prix de la violation de sa neutralité. Si cet espoir était déçu, le Gouvernement belge est fermement décidé à repousser par tous les moyens en son pouvoir, toute atteinte à son droit.
Albert Ier ordonne alors la destruction des ponts et des tunnels à la frontière allemande et prend la tête de l’armée tandis que la violation de la neutralité belge provoque l’entrée en guerre du Royaume-Uni contre l’Allemagne.
Ainsi, en quelques jours, toutes les grandes puissances européennes liées par des alliances se retrouvent engagées, non par choix individuel mais par obligation de soutenir leurs alliés.

Dès les premiers jours, la Belgique déploie une résistance remarquable face à l’envahisseur. La défense de Liège, véritable forteresse entourée de douze forts modernes, devient le premier acte de bravoure. Pendant plus de dix jours, ces forts repoussent les attaques massives de l’artillerie allemande, notamment le redoutable canon « Grosse Bertha ». Cette résistance inespérée surprend l’armée allemande et ralentit considérablement son avancée vers la France, donnant ainsi un temps précieux aux Alliés pour s’organiser. Pendant ce temps, des combats éclatent un peu partout dans le pays, entre petites villes et villages, et le roi Albert Ier, refusant de fuir, reste aux côtés de ses troupes, symbolisant le courage et la détermination du peuple belge.
Face aux assauts répétés, l’armée belge recule stratégiquement vers Anvers, autre place forte essentielle. La lutte se poursuit avec ténacité dans cette région, mais c’est sur le front de l’Yser que la Belgique joue un rôle décisif. Confrontés à l’avancée allemande vers la mer, les Belges et leurs alliés prennent la décision audacieuse d’inonder une partie des terres en ouvrant les écluses de Nieuport. Cette manœuvre spectaculaire bloque la progression ennemie et empêche la capture des ports de la Manche, vitaux pour les lignes d’approvisionnement alliées. La bataille de l’Yser scelle ainsi la tenue d’un front solide jusqu’à la fin du conflit, malgré des conditions de combat extrêmement difficiles.
Mais la bravoure de l’armée belge ne se limite pas aux champs de bataille : elle s’étend à toute la population qui endure une occupation allemande brutale et implacable. La vie quotidienne devient un combat permanent contre la faim, les réquisitions de vivres et de matériels, ainsi que la répression. Plus de 60 000 civils sont déportés pour des travaux forcés en Allemagne, tandis que la censure, la surveillance et la violence s’intensifient année après année. Les massacres de civils, dont ceux de Dinant ou de Louvain, laissent des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Pourtant, malgré cette sombre réalité, la population belge fait preuve d’une solidarité exemplaire, multipliant les actes de résistance clandestine et maintenant vivace l’esprit patriotique au cœur même de l’oppression.
Dans le même temps, le gouvernement belge, contraint à l’exil, refuse de céder. Installé à Sainte-Adresse, près du Havre en France, il poursuit son rôle de chef d’État, coordonnant la mobilisation des forces et soutenant les millions de réfugiés belges dispersés en France, au Royaume-Uni et dans les Pays-Bas. Tandis que le roi Albert Ier choisit de rester avec ses soldats sur le sol belge, incarnant la résistance héroïque, le gouvernement veille à conserver la souveraineté du pays sur la scène internationale. Cette dualité – un gouvernement en exil et un roi sur le front – exprime toute la profondeur de l’engagement belge face à l’envahisseur.
Illustration:
– Une du journal Le soir.
– Images des mobilisations allemande et belge. – vrt.be