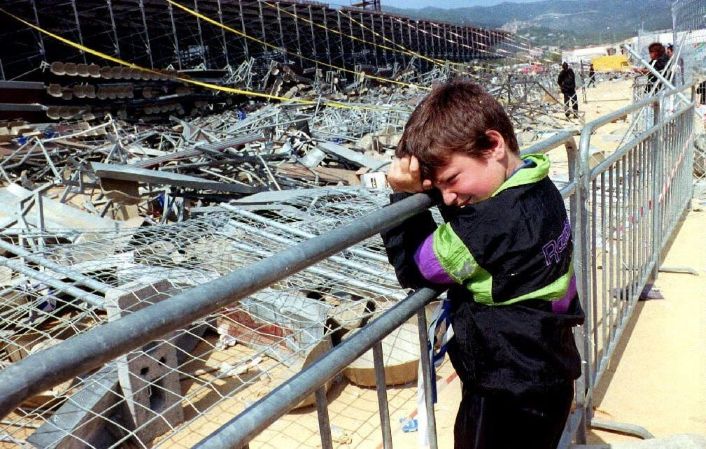Au cœur des montagnes verdoyantes de l’Ouest Cameroun se niche un lac aux allures paisibles. Les eaux immobiles et silencieuses du lac Nyos, enchâssé dans le cratère d’un ancien volcan, reflètent le ciel comme un miroir. Mais sous sa surface trompeuse dort une menace que nul ne soupçonne… jusqu’à la nuit tragique du 21 août 1986.
Ce soir-là, alors que les villageois s’endorment paisiblement, un cataclysme invisible se prépare. À 21 h, une sourde explosion trouble l’eau du lac. En quelques minutes, un gigantesque panache de dioxyde de carbone (CO₂), accumulé depuis des décennies dans les abysses du cratère, se libère brutalement. Coloré de rien, inodore, ce gaz, plus lourd que l’air, dévale silencieusement les pentes, se glisse dans les vallées comme un brouillard empoisonné.
Le lendemain, le soleil se lève sur un paysage figé. Les villages alentour restent muets, les huttes sont désertées. Plus de 1 746 personnes sont mortes dans leur sommeil, asphyxiées sans comprendre. Des milliers de bêtes gisent au sol – bovins, chèvres, oiseaux, même les insectes disparaissent. Les arbres restent étrangement intacts, mais la vie s’est éteinte, balayée par un souffle de mort que personne n’a vu ni entendu venir.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Un mystère percé par la science
Ce phénomène, inconnu du grand public avant cette tragédie, porte un nom : éruption limnique. Contrairement aux éruptions volcaniques classiques, il n’y a ni torrents de lave, ni pluie de cendres. Ici, c’est une géologie silencieuse et invisible qui tue en suivant un processus glaçant :
- Dans les profondeurs du lac, l’eau se sature en gaz issus du volcanisme souterrain.
- La pression maintient ce CO₂ dissous dans l’eau, comme le gaz piégé dans une bouteille de soda.
- Il suffit d’un déclencheur – glissement de terrain, petite secousse, ou même un refroidissement soudain – pour rompre l’équilibre fragile.
- Alors, comme une bouteille brusquement décapsulée, le gaz s’échappe en masse, jaillit vers la surface et s’écroule sur les rives.
Le Cameroun découvre ainsi qu’il abrite des lacs capables de se transformer en armes naturelles de destruction massive, sans flammes et sans bruit, uniquement par le souffle invisible du CO₂.
Survivre au monstre endormi
Face à l’horreur, la communauté scientifique internationale se mobilise. Des chercheurs camerounais, français, américains et japonais affluent pour étudier ce lac meurtrier. Comment empêcher que Nyos – ou d’autres lacs similaires – ne fassent à nouveau des victimes ?
La solution se révèle inédite et ingénieuse : installer de longues colonnes plongeant jusqu’au fond du lac. Ces tuyaux de dégazage, semblables à d’immenses pailles, laissent le gaz remonter lentement et s’échapper de façon contrôlée. À la surface, ils créent des fontaines bouillonnantes spectaculaires, véritables soupapes de sécurité contre la répétition du drame.
Mais la vigilance reste constante. Les flancs mêmes du cratère se fragilisent : un éboulement peut briser la digue naturelle du lac, libérant à la fois les eaux et le gaz encore accumulé. Nyos ne cesse d’inquiéter.

Une menace mondiale
L’histoire du Nyos ne reste pas un simple drame local : elle révèle au monde entier l’existence d’un type de menace naturelle jusque-là méconnue. Les éruptions limniques apparaissent désormais comme un risque global, touchant d’autres lacs volcaniques situés en Afrique et potentiellement ailleurs.
À seulement 100 kilomètres du Nyos, le lac Monoun a connu deux ans auparavant, en 1984, un phénomène similaire. Ce jour-là, une quarantaine de personnes meurent, surprises par un nuage de CO₂ qui s’échappe brutalement des eaux profondes. L’événement passe relativement inaperçu hors du Cameroun, mais rétrospectivement, il s’agit bien là d’un signal d’alarme ignoré. Ce n’est qu’après la catastrophe du Nyos que les scientifiques comprennent que les deux drames relèvent du même processus.
Encore plus inquiétant se trouve plus à l’est, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda : le lac Kivu. Celui-ci n’a pas encore connu d’éruption limnique, mais il est surveillé avec une particulière appréhension. Profond et gigantesque — cinquante fois le volume du Nyos — il abrite une véritable mer souterraine de gaz. On estime qu’il contient plus de 300 kilomètres cubes de dioxyde de carbone, mais aussi environ 65 kilomètres cubes de méthane, un gaz hautement inflammable et explosif. Une libération brutale de cette nappe gazeuse ne se contenterait pas d’asphyxier les populations riveraines : elle pourrait engendrer des explosions, voire des tsunamis lacustres.
La menace devient ici vertigineuse : autour du lac Kivu vivent près de deux millions de personnes, dont une grande partie dans les villes de Goma (RDC) et de Gisenyi (Rwanda). Si un dégazage incontrôlé se produit, les conséquences dépassent largement la tragédie de Nyos. Des chercheurs n’hésitent pas à qualifier Kivu de « bombe à retardement » naturelle, un monstre aquatique endormi dont nul ne peut prédire le réveil.
L’Afrique n’est peut-être pas la seule concernée. Des études s’intéressent aujourd’hui à d’autres lacs volcaniques à travers le monde. Des formations similaires existent en Amérique centrale, dans le sud de l’Italie ou en Indonésie, même si aucune n’atteint l’ampleur et la dangerosité du Kivu. L’enjeu est désormais de recenser, surveiller et équiper ces lacs potentiellement instables avec des systèmes de dégazage préventif.
Illustration: image générée par IA