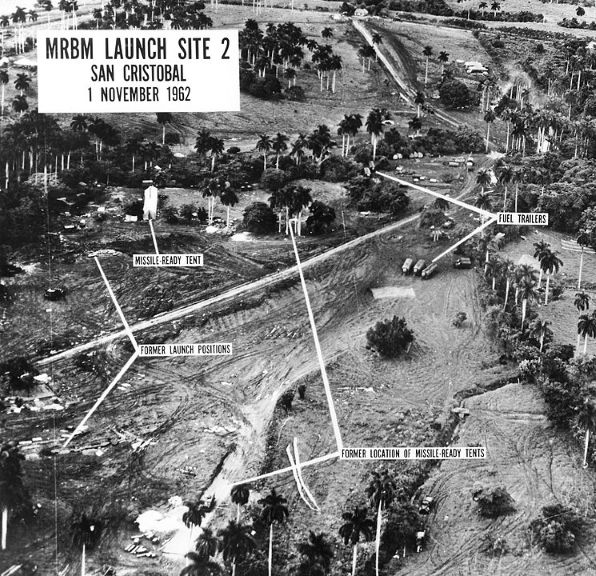Le 25 août 1632, à l’abbaye Saint-Martin d’Autun, un moment historique attire une foule nombreuse. Ce jour-là, le tombeau de la reine Brunehaut est ouvert solennellement. Dévoiler le contenu de ce sépulcre, conservé depuis plusieurs siècles, excite la curiosité de nombreux habitants, religieux et notables.
Sommaire
Qui est Brunehaut ?
Brunehaut est née vers 547 dans la royauté wisigothe en Espagne. Princesse devenue reine des Francs grâce à son mariage avec Sigebert Ier, roi d’Austrasie, elle incarne la puissance féminine au cœur d’un pouvoir largement masculin. Sa beauté, son intelligence et sa détermination la placent au centre de la vie politique.
Lorsque son mari est assassiné, elle ne se retire pas, au contraire, elle prend en main la régence du royaume. Pendant plus de trois décennies, Brunehaut gouverne avec poigne, intervenant dans la vie militaire, administrative et diplomatique. Elle réorganise le territoire, répare les infrastructures et engage des réformes qui modernisent son royaume.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Un règne sous tension
Régner à cette époque est un défi permanent. Pour Brunehaut, ce n’est pas différent. Dès la disparition de son époux, elle doit défendre farouchement le trône pour son fils Childebert II puis ses petits-fils Théodebert II et Thierry II. Son autorité rencontre souvent la méfiance et l’hostilité de la puissante noblesse austrasienne, qui souhaite limiter son emprise.
Néanmoins, par une habile diplomatie et des alliances, notamment avec le roi de Bourgogne, Brunehaut réussit à maintenir l’unité de ses terres. Sa réputation de dirigeante forte s’impose malgré les jalousies et les complots, ce qui lui vaut respect mais aussi rancunes chez ses adversaires.
L’Austrasie et la Neustrie
À l’époque mérovingienne, l’Austrasie et la Neustrie désignent deux des royaumes francs principaux, aux territoires vastes et distincts. L’Austrasie couvre le nord-est de la France actuelle, incluant la Champagne, la Lorraine, l’Alsace, ainsi que la majeure partie de la Belgique, une partie de la Hollande, le Luxembourg et une frange occidentale de l’Allemagne. Ce territoire est le berceau des Mérovingiens orientaux et connaît un mélange culturel important, mêlant influences romaines, germaniques et chrétiennes.
La Neustrie, en revanche, s’étend sur le nord-ouest de la France actuelle, sans inclure la Bretagne. Elle est historiquement considérée comme le domaine plus romain et tournée vers l’Atlantique, avec des centres comme Paris et Orléans. Ces deux royaumes, bien que frères, sont souvent en rivalité politique, chacun gouverné par une branche différente de la dynastie mérovingienne, avec des identités culturelles et politiques distinctes.
Une rivalité sanglante
La rivalité entre Brunehaut et Frédégonde est au cœur des luttes de pouvoir qui déchirent la Gaule mérovingienne à la fin du VIe siècle. Brunehaut, princesse wisigothe mariée au roi Sigebert Ier d’Austrasie, et Frédégonde, issue d’un milieu modeste devenue reine de Neustrie après avoir été la maîtresse puis l’épouse du roi Chilpéric Ier, incarnent deux visions opposées et une lutte sans merci pour la domination politique.
L’assassinat de Galswinthe, sœur de Brunehaut et première épouse de Chilpéric, assuré par Frédégonde, déclenche une vendetta meurtrière. Les deux femmes s’affrontent sur plusieurs décennies dans un conflit mêlant stratégies, intrigues, guerres et assassinats. Chacune cherche à défendre l’honneur de sa famille tout en éliminant ses ennemis sans pitié. Frédégonde, réputée pour sa cruauté, n’hésite pas à faire assassiner l’évêque de Rouen et d’autres rivaux, tandis que Brunehaut use de son intelligence et de ses alliances pour consolider son pouvoir. Leur affrontement plonge la région dans une guerre civile sanglante et durable.
Une fin dramatique
Frédégonde meurt la première. Mais l’histoire de Brunehaut se conclut tout de même dans la douleur et l’humiliation.
Après avoir enduré des années de guerres et d’intrigues, elle perd peu à peu ses soutiens. En 613, elle est capturée par Clotaire II, fils de Frédégonde, son ennemie jurée. Soumise à un procès cruel, Brunehaut subit un supplice atroce : humiliée en public, elle est promenée nue parmi les soldats, puis achevée dans une mise à mort barbare consistant à être traînée au sol attachée à un cheval fou. C’est une fin brutale, reflet de la violence de son époque. Son corps est ensuite brûlé, mais ses restes sont recueillis et déposés dans l’abbaye qu’elle a fondée, un ultime hommage.

Que deviennent ses restes ?
Lors de l’ouverture du tombeau de Brunehaut en 1632, les restes retrouvés témoignent de cette existence tourmentée. Le cercueil renferme des os carbonisés, des cendres, et une molette d’éperon, symbole des combats et de son destin ardent. Les reliques sont délicatement replacées dans le sarcophage de plomb. Cependant, la Révolution française éclate plus tard et détruit le sépulcre, dispersant les vestiges. Heureusement, des fragments du tombeau sont conservés au musée Rolin d’Autun, perpétuant la mémoire d’une reine au destin hors du commun.
Illustration: Brunehaut face à Frédégonde. – Image générée par IA