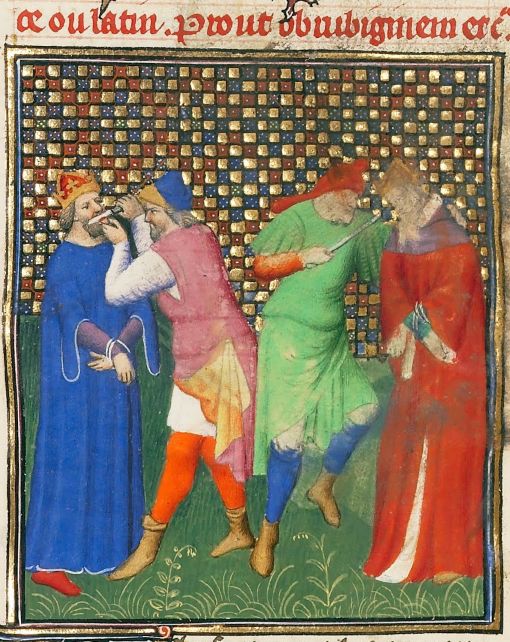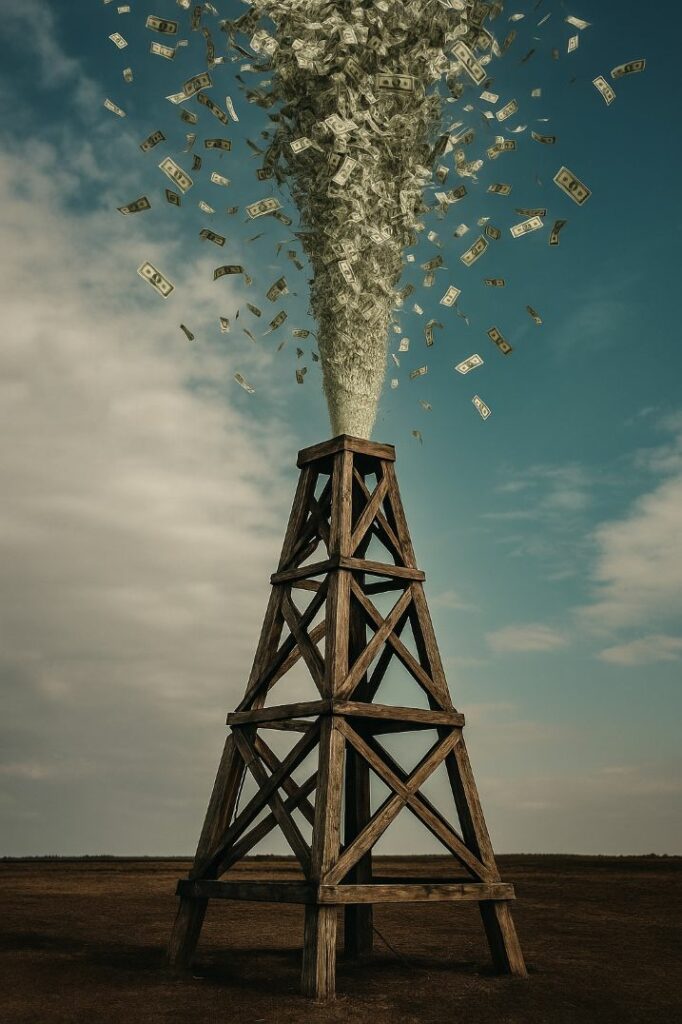Dans le contexte de la guerre froide, le 14 septembre 1954, l’Union soviétique lance une série d’exercices militaires visant à se préparer à la possibilité d’un conflit atomique de grande échelle. L’événement, baptisé « Snezhok » (« Boule de neige » en français), se déroule sur un vaste polygone militaire à proximité du village de Totskoïe, au sud de l’Oural, dans la région d’Orenbourg.
L’URSS cherche à démontrer sa capacité non seulement à employer l’arme nucléaire, mais aussi à diriger et à faire manœuvrer de grandes unités militaires dans des conditions post-nucléaires, tout en testant les conséquences physiologiques et tactiques d’un tel choc sur les troupes et les équipements. Cet exercice reste pendant des décennies entouré du plus grand secret, symbole de la brutalité de l’affrontement idéologique et technologique entre les blocs Est et Ouest.
Les objectifs
L’objectif officiel de l’opération Snezhok est de simuler une percée à travers des lignes de défense fortifiées ennemies en environnement nucléaire, une hypothèse jugée plausible par les stratèges de l’Armée rouge face à l’OTAN. En réalité, l’exercice se double d’une expérimentation grandeur nature visant à mesurer les effets d’une explosion atomique sur des soldats vivants, des équipements et des structures, ainsi qu’à observer la possibilité d’utiliser une telle frappe comme instrument tactique sur un champ de bataille. Pour cela, l’état-major soviétique mobilise 45 000 hommes des forces terrestres, soutenus par 6 000 officiers, près de 600 chars, 600 véhicules blindés et 320 avions. L’ensemble est commandé par le maréchal Gueorgui Joukov, figure de proue de la victoire soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, et observé par plusieurs hauts dignitaires militaires étrangers, dont des représentants chinois, polonais et tchécoslovaques.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Le déroulement
Le matin du 14 septembre 1954, à 9h33, un bombardier Tu-4 soviétique largue une bombe RDS-4 d’une puissance estimée à 40 kilotonnes, soit environ deux à trois fois celle d’Hiroshima. La bombe explose à 350 mètres au-dessus du sol, à une dizaine de kilomètres du village de Totskoïe. Quelques minutes seulement après la détonation, alors que le champignon atomique n’est pas totalement dissipé et que la radioactivité atteint encore des niveaux très élevés, les premiers contingents de soldats reçoivent l’ordre d’entrer dans la zone sinistrée et de mener une attaque simulée. Les militaires n’ont reçu, dans la plupart des cas, aucune protection spéciale contre les radiations : beaucoup ignorent même la nature véritable de l’essai et pensent participer à un entraînement classique ou à la simulation d’une explosion nucléaire fictive. Artillerie et aviation interviennent également sur la zone irradiée dans les minutes suivantes, renforçant le réalisme de l’expérience du point de vue soviétique. Des équipes spécialement formées, à bord de chars servant de protection partielle, sont chargées de mesurer les retombées et de baliser les zones interdites selon des niveaux de contamination allant jusqu’à 25 Röntgens/heure à proximité de l’épicentre.

Les conséquences
Si l’exercice remplit ses objectifs tactiques, les conséquences humaines et sanitaires sont dramatiques. De nombreux soldats, mais aussi des habitants de villages proches – dont les opérations d’évacuation sont incomplètes ou tardives – sont exposés à de fortes doses de radiations. Les retombées contaminent également l’environnement local, étendant les effets nocifs sur des décennies. Les dossiers médicaux des victimes disparaissent parfois mystérieusement des hôpitaux pour masquer l’ampleur du désastre. Il est difficile d’établir un bilan précis, l’URSS entretenant une omerta totale jusqu’aux années 1990. Les estimations font état de milliers de victimes parmi les participants directs (beaucoup sont handicapés, souffrent de maladies graves ou meurent prématurément) et les populations voisines. La reconnaissance officielle des vétérans concernés reste très tardive et parcellaire : cinquante ans après, une minorité d’entre eux survit, la grande majorité étant gravement malade ou décédée.
L’exercice Snezhok incarne à lui seul la logique terrifiante de la guerre totale envisagée par les puissances atomiques durant la guerre froide. Par l’expérimentation brutale de la guerre nucléaire « grandeur nature » sur des hommes souvent non informés ni protégés, l’URSS montre à la fois la détermination stratégique de ses dirigeants et le cynisme implacable de certains choix militaires. Ce test massif, longtemps maintenu secret, reste un dossier traumatique dans l’histoire des essais nucléaires, illustrant les dérives de l’expérimentation humaine orchestrée par les États au nom de la sécurité nationale ou du progrès technique.
Illustration: Image générée par IA