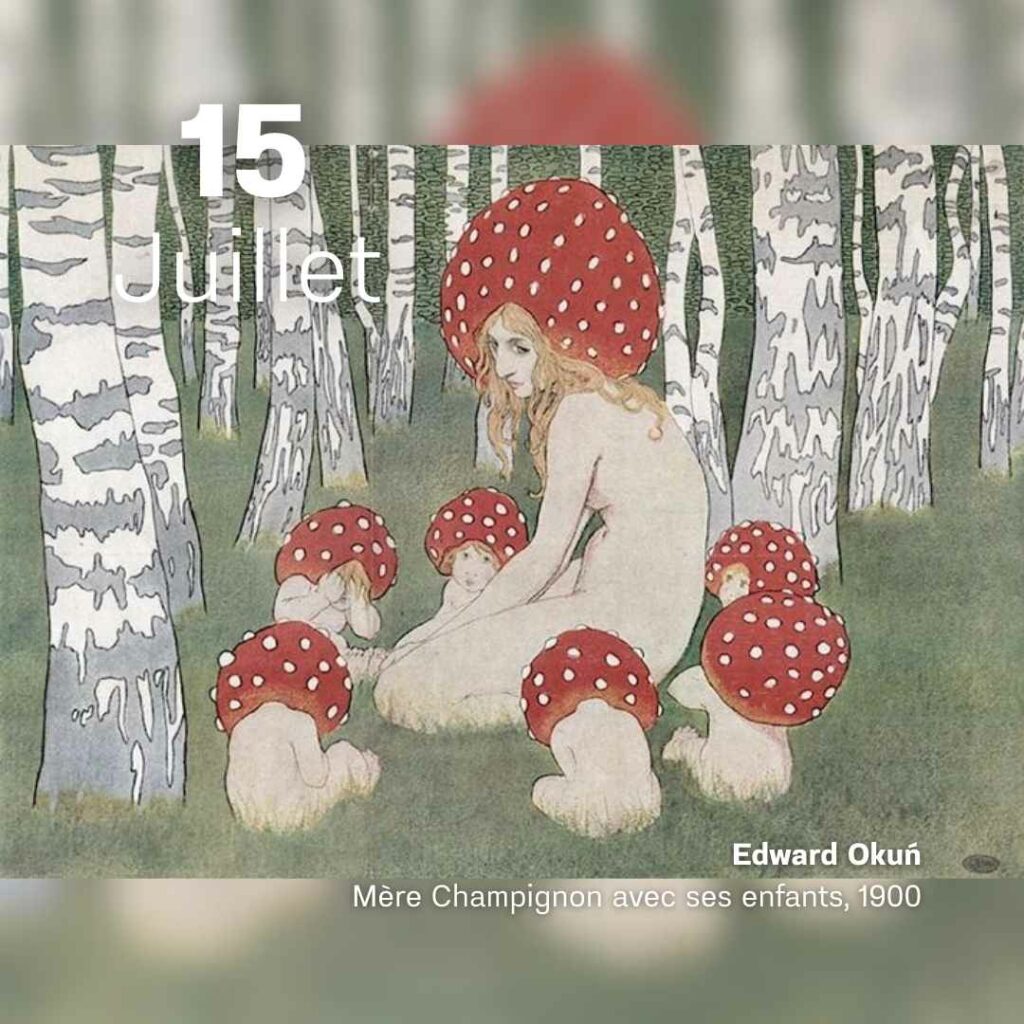Aujourd’hui, le 14 octobre, le calendrier républicain français célèbre le « jour du Navet », clin d’œil à cet humble légume souvent méconnu et parfois moqué. Cette date rappelle que le navet occupe une place discrète mais persistante dans le patrimoine agricole et culinaire de la France. Lors de la Révolution, la République accorde une grande importance aux produits de la terre, et chaque journée du calendrier célèbre une plante, un animal ou un outil. Le navet, associé à la simplicité paysanne et à la subsistance, obtient ainsi son propre jour de fête, preuve de son ancrage dans la culture populaire.
Le navet s’offre d’abord comme une première rencontre familière avec le potager. Il accompagne les saisons et les gestes du maraîcher, se prêtant à toutes les adaptations : en gratin, mijoté, glacé, avec la viande ou seul. Cultivé en Europe et en Asie depuis des millénaires, il s’impose dès l’Antiquité sur les tables grecques et romaines. Au Moyen Âge, il figure parmi les aliments quotidiens, surtout dans les campagnes, nourrissant des générations entières. La pomme de terre, plus facile à produire et nourrissante, ne prendra sa place qu’au XVIIIème siècle. Pendant des siècles, le navet représente la rusticité, la subsistance et, pour beaucoup, l’aliment du pauvre, ce qui explique en partie la connotation peu flatteuse dont il a hérité.
Physiquement, le navet se distingue par sa racine charnue, qui peut prendre des formes diverses : sphérique, plate ou conique, et revêtir des teintes blanches, jaunes, mauves, parfois bicolores. En bouche, il offre une saveur douce, parfois relevée d’une note piquante selon la variété et le terroir d’origine. Sur le plan nutritionnel, il coche de nombreux atouts modernes : faible apport calorique, richesse en fibres, potassium, vitamine C, tout en restant bon marché et simple à préparer. On redécouvre aujourd’hui, dans les marchés ou les restaurants, la palette de variétés locales oubliées et le mariage heureux du navet avec la gastronomie contemporaine.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Au-delà de l’aliment, le navet est un mot chargé de sous-entendus dans la langue française. Depuis le XIIIe siècle, il fonctionne comme une métaphore pour tout ce qui paraît insignifiant, médiocre, fade ou sans intérêt. On explique ce glissement sémantique par la réputation du navet, légume banal, nourrissant mais peu prisé, qui n’éveille ni enthousiasme ni admiration. Des anecdotes rapportent qu’au XVIIIe siècle, les étudiants en art surnomment la fameuse statue antique de l’Apollon du Belvédère « le navet épluché », moquant sa pâleur et ses formes jugées trop fades. Ce sarcasme traverse les sphères artistiques, et au XIXe siècle, « navet » devient la formule consacrée pour épingler tableaux, pièces de théâtre et, bientôt, films jugés ratés, ternes ou dépourvus d’inspiration. Le navet, dans son emploi figuré, consacre donc une œuvre fade, laborieuse, dont le principal défaut est de laisser le spectateur indifférent ou déçu.
Pourtant, tous les films médiocres ne sont pas logés à la même enseigne, car un « navet » se distingue d’un « nanar » ! Un navet se contente d’être mauvais et ennuyeux. Il désole par sa platitude, ne suscite ni plaisir ni moquerie, se limite à l’échec. À l’inverse, le nanar, expression venue de l’argot du XIXe siècle signifiant au départ « vieillerie » ou « objet sans valeur », a évolué au fil du XXème siècle pour s’appliquer aux films tellement mauvais qu’ils en deviennent involontairement drôles, absurdes ou joyeusement ratés. Un nanar est donc un mauvais film, mais dont l’accumulation de maladresses, d’exagérations ou de fautes de goût provoque le rire, la fascination, parfois même l’attachement. Il n’est pas rare de voir des cinéphiles organiser des soirées nanar, regardant avec délice ces œuvres improbables, là où un navet n’invite qu’au bâillement. La frontière ? Le plaisir involontaire, le ridicule assumé ou non.
Curieusement, la longue histoire du navet croise aussi celle d’Halloween. Avant qu’on ne sculpte des citrouilles à la Toussaint, c’est le navet que les Irlandais découpaient pour en faire des lanternes terrifiantes. Cette tradition ancestrale s’appuie sur la légende de Jack-o’-lantern : condamné à errer sur terre, Jack enfonce une braise dans un navet creusé, éclairant sa route lors de la nuit des morts. En migrant en Amérique, les Irlandais troquent le navet, trop dur à évider, contre la citrouille qui abonde sur leur nouveau continent, ce qui explique pourquoi aujourd’hui, la « pumpkin » a éclipsé le navet dans l’imaginaire collectif. Pourtant, dans certains villages du Royaume-Uni ou d’Irlande, on continue de sculpter des navets pour Halloween, en hommage aux légendes d’antan.
Alors, le navet demeure-t-il un mal aimé ? À la fois légume modeste, insulte culinaire ou cinéphilique, symbole d’ingéniosité populaire et d’humour involontaire, il n’en finit pas de renaître de ses cendres. En ce jour du navet, on peut lui rendre hommage sans gêne : dans l’assiette pour les papilles curieuses, sur l’écran pour l’indulgence, ou dans nos expressions pour se souvenir qu’un brin de dérision accompagne parfois les plus beaux hasards de la langue.
Il reste une question : et toi alors 😊 es-tu ceci (légume) 👇 ?
ou cela (cinéma) 👇 ?
Illustration: film sur Jack-O-Lantern en navet tenant un navet. – Image IA