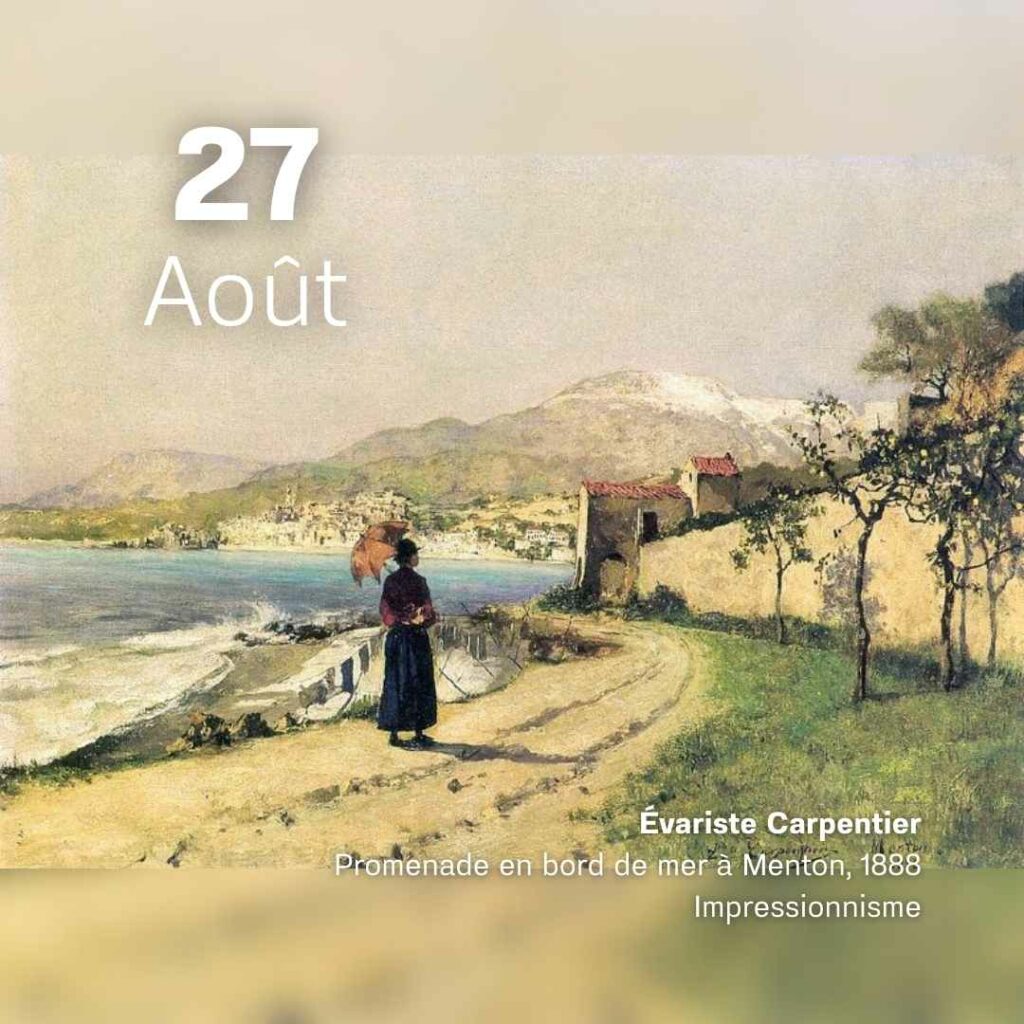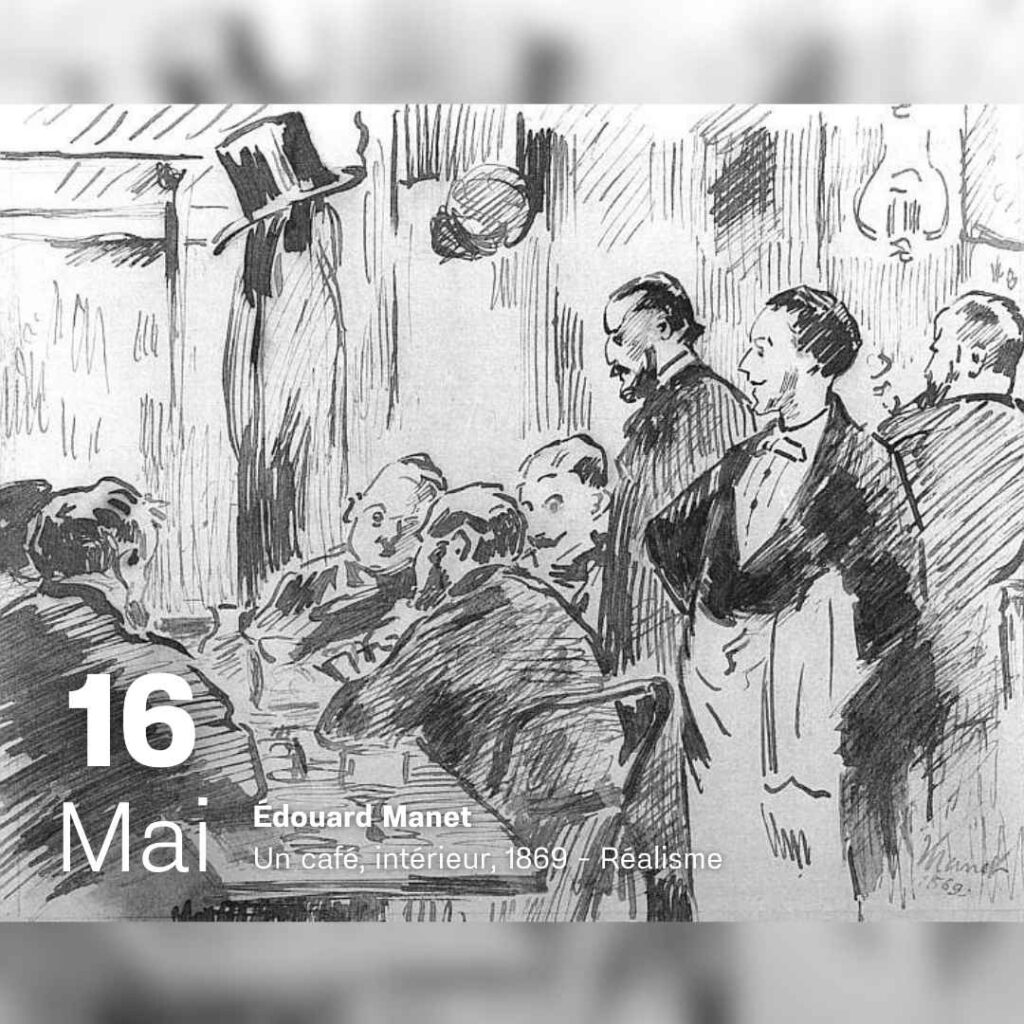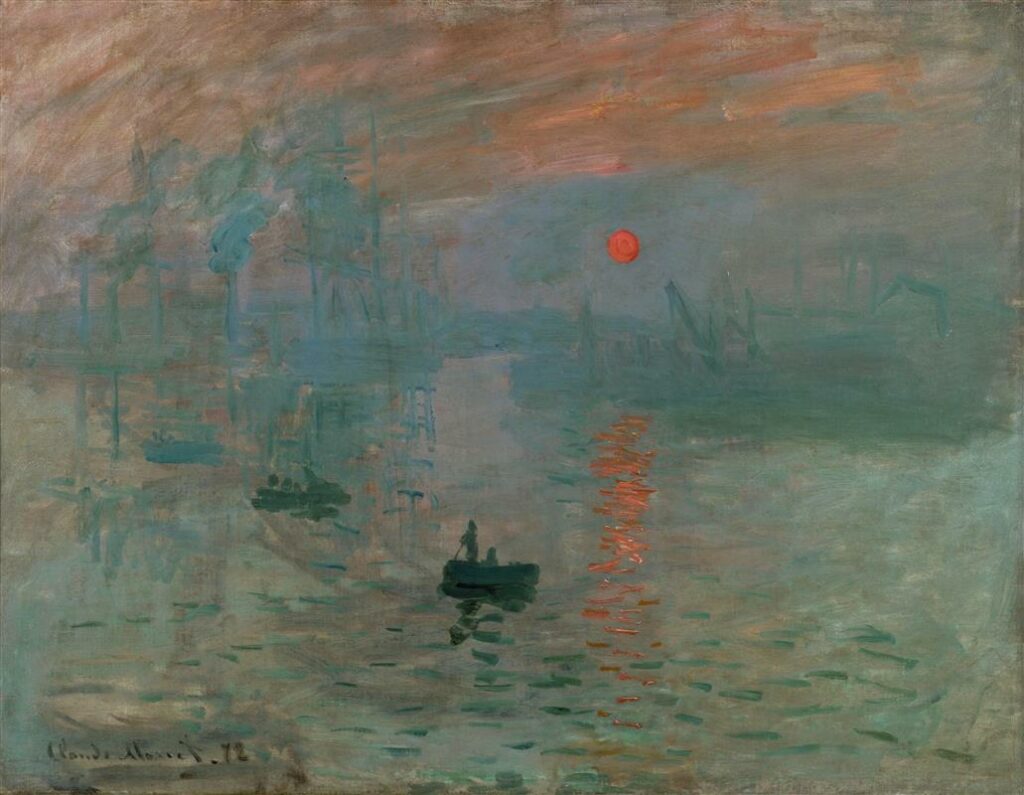Le 18 octobre 1973, la France accueille en salles « Les Aventures de Rabbi Jacob », qui s’impose comme l’un des événements les plus marquants du cinéma populaire hexagonal. L’ambiance des cinémas parisiens bruisse d’excitation : les spectateurs se pressent pour découvrir la nouvelle folie de Louis de Funès, orchestrée par le réalisateur Gérard Oury. L’équipe du film, menée par la scénariste Danièle Thompson, ne cache pas son stress face à l’accueil du public, tant le contexte international apparaît explosif ce jour-là.
Sommaire
Un tourbillon diplomatique
La sortie de « Rabbi Jacob » intervient à un moment d’intenses tensions sur la scène internationale.
En ce mois d’octobre 1973, la guerre du Kippour éclate au Moyen-Orient : Israël doit faire face à une attaque soudaine menée par l’Égypte et la Syrie. L’émotion est vive en France, où la communauté juive et de nombreux citoyens suivent avec inquiétude la progression du conflit.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Au même moment, la question du pétrole prend une tournure dramatique : les pays arabes, furieux du soutien américain à Israël, déclenchent un embargo qui provoque le premier choc pétrolier. Le prix du baril s’envole, la panique gagne l’Europe, et la société française se trouve secouée par cette crise inédite.
Dans ce climat explosif, Danièle Thompson sillonne nuit et jour les rues de Paris : au lieu de coller les affiches de son film, elle se voit contrainte de les retirer par crainte de représailles ou d’incidents. Tous les regards se portent sur « Rabbi Jacob », devenu bien malgré lui un symbole de courage et de risque dans un contexte aussi tendu.
Une intrigue entre rire et humanité
Dans une France en crise, le film propose une bouffée salvatrice d’humour et d’humanité.
Victor Pivert, industriel colérique et caricature de la petite bourgeoisie raciste, traverse une série de mésaventures rocambolesques. Pris dans un engrenage absurde, il se voit contraint de fuir aux côtés de Slimane, un révolutionnaire en cavale. Le duo improbable traverse alors Paris, plonge dans la fameuse cuve de chewing-gum d’une usine de bonbons, prend la place de rabbins, est entraîné dans une danse hassidique traditionnelle au milieu de la rue des Rosiers, etc.
Les spectateurs se laissent emporter par ce ballet burlesque, qui, sous couvert de farce, pose des questions brûlantes : la peur de l’autre, les préjugés, la possibilité du rire comme levier de fraternité. Au fil des scènes, le film s’offre en véritable plaidoyer pour la tolérance, le vivre-ensemble et l’empathie, tout en multipliant les gags qui deviendront cultes.
Le détournement d’avion
Cette euphorie ne masque toutefois pas la marque tragique qui accompagne la sortie du film.
Le même jour, Danielle Cravenne, épouse du publicitaire en charge de la promotion, détourne le vol Air France Paris-Nice, arme factice à la main. Animée par des convictions politiques exacerbées dans le contexte de la guerre du Kippour, elle réclame l’annulation pure et simple de la sortie du film, qu’elle juge trop favorable à la cause juive et donc dangereusement provocatrice.
L’avion atterrit à Marseille, où le GIPN donne l’assaut : les passagers sont libérés, mais Danielle Cravenne, blessée lors de l’intervention, meurt pendant son transfert à l’hôpital. Ce drame jette une ombre noire sur la fête, rappelant avec brutalité que l’art, même comique, peut cristalliser toutes les passions et tous les conflits de l’époque. La sortie du film s’en retrouve bouleversée, le traumatisme s’ajoute à la charge symbolique de « Rabbi Jacob », désormais indissociable de cet épisode tragique du 18 octobre 1973.
La cuve de chewing-gum
Impossible de ne pas revenir sur la scène mythique de la cuve de chewing-gum qui aurait pu compromettre le tournage du film.
Le fameux bac, censé contenir de la gomme verte, recèle en réalité un mélange de farine, de glucose, de colorant alimentaire et parfois même de pâte à crêpes. Cette inventivité artisanale coûte cher à l’équipe : Gérard Darmon, jeune acteur dans le film, souffre d’un décollement de cornée en raison du mélange, et Louis de Funès devra consulter le même ophtalmologue le lendemain. La séquence, prévue pour quelques jours, s’étire sur plus d’une semaine, rythmée par l’entraide, les galères techniques, mais aussi les fous rires collectifs autour de cette glu collante et illusoire.
Pour le spectateur, la magie opère : la scène devient culte et symbolise tout l’art du cinéma populaire français, où l’artisanat et la débrouille servent la créativité et la comédie jusqu’à marquer à jamais la mémoire collective.
Illustration: « Les Aventures de Rabbi Jacob », de Gérard Oury (1973). Films Pomereu – Télérama