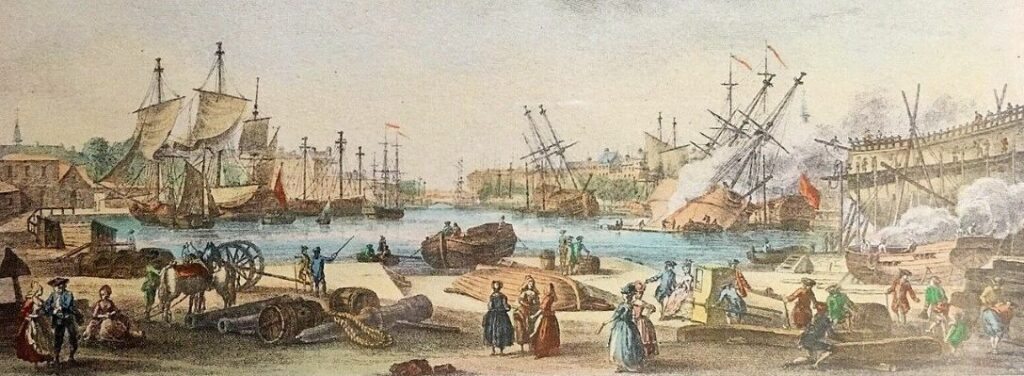Le 25 mars 1949 marque l’un des jours les plus sombres de l’histoire des pays baltes. Ce jour-là, les autorités soviétiques lancent l’opération Priboï, une déportation massive qui arrache près de 90 000 Estoniens, Lettons et Lituaniens à leur terre natale pour les envoyer vers les goulags sibériens. Parmi les victimes figurent des milliers de femmes et d’enfants, dont beaucoup ne reviendront jamais.
L’opération Priboï (qui signifie « déferlante » en russe) représente la plus grande déportation organisée par Staline dans les pays baltes. Planifiée dès janvier 1949, elle vise officiellement à « éliminer les ennemis du peuple » et à briser la résistance à la collectivisation forcée des campagnes. En réalité, il s’agit d’une purge ethnique destinée à asseoir le contrôle soviétique sur ces territoires récemment annexés.
Les populations déportées sont sélectionnées avec une précision méthodique. Le NKVD établit des listes ciblant principalement les paysans propriétaires qualifiés de « koulaks », les familles de résistants et les intellectuels suspectés d’hostilité au régime. Il suffit parfois de posséder plus de 10 hectares de terre ou d’avoir refusé d’intégrer un kolkhoze pour figurer sur ces listes. Les arrestations touchent délibérément les familles dans leur ensemble, y compris les nouveau-nés et les personnes âgées.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
L’opération se déroule avec une brutalité calculée. Entre le 25 et le 29 mars, des commandos du NKVD assistés de collaborateurs locaux frappent aux portes à l’aube. Les familles ont à peine 30 minutes pour préparer quelques affaires avant d’être emmenées vers les gares. Soixante-six trains à bestiaux les attendent, gardés par la 48e division du MVD. Les conditions du voyage sont effroyables : entassement, faim, froid extrême et absence d’hygiène. Beaucoup ne survivent pas au trajet.
Les survivants sont dispersés dans les régions les plus inhospitalières de Sibérie. Affectés aux travaux forcés dans les kolkhozes ou les mines, ils doivent faire face à des températures descendant sous les -40°C en hiver. Environ 3 000 Estoniens périssent durant la première année. Ce n’est qu’après la mort de Staline en 1953 que certains pourront rentrer, retrouvant souvent leurs biens confisqués et leurs fermes occupées par des colons russes.
Les « Frères de la forêt », ces résistants nationalistes qui mènent une guérilla contre l’occupation soviétique depuis 1944, sont directement visés par ces déportations. Privés de leur base sociale rurale, ces combattants voient leur mouvement s’affaiblir progressivement. Le dernier d’entre eux, August Sabbe, est retrouvé en Estonie en 1978. Selon la légende, il préfère se suicider plutôt que de se rendre au KGB.
Les organisateurs de l’opération sont largement récompensés pour leur zèle. Les officiers du NKVD reçoivent promotions et décorations, comme l’Ordre du Drapeau rouge. Les collaborateurs locaux s’approprient les biens des déportés. Parmi eux, Arnold Meri, un héros de guerre estonien pro-soviétique, qui supervise les déportations dans l’île de Hiiumaa. En 2007, l’Estonie indépendante l’inculpe pour génocide, mais il meurt avant son procès. La Russie, elle, lui décerne à titre posthume l’Ordre d’Honneur, saluant son « combat contre le nazisme ».
Aujourd’hui, le 25 mars reste une date mémorielle majeure dans les pays baltes. Des veillées aux bougies illuminent les places publiques, comme celle de la Liberté à Tallinn. En 2024, pour le 75e anniversaire, les présidents baltes établissent un parallèle avec la guerre en Ukraine, dénonçant une « méthodologie répressive » toujours active. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu ces déportations comme crimes contre l’humanité. Ces événements fondent toujours l’identité nationale balte et justifient leur ferme position face à Moscou.
Photo: Estoniens déportés, mars 1949, source : Erakogu