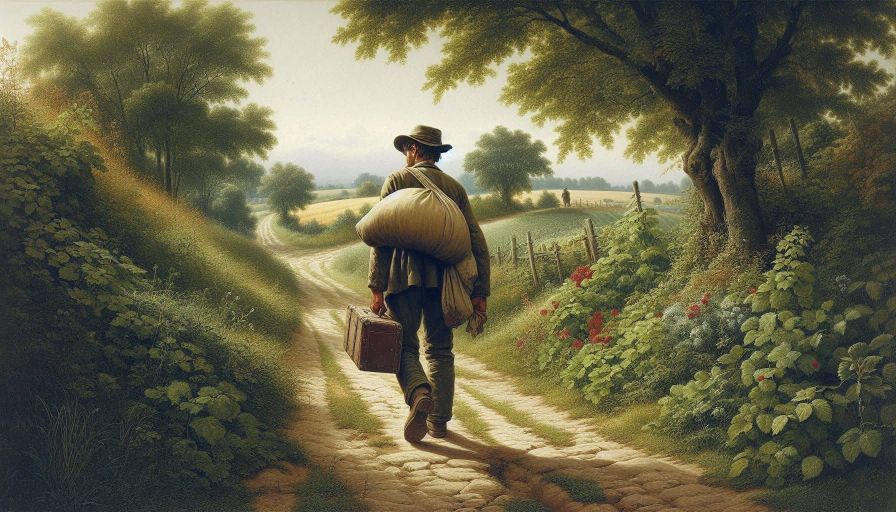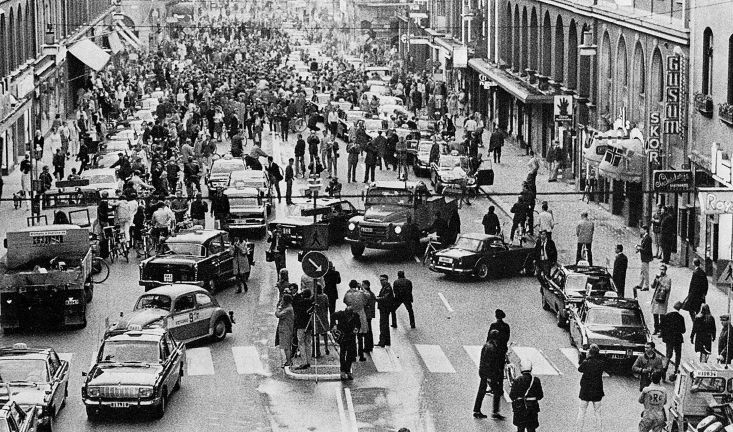Le 7 octobre 2023 en Israël, la réalité bascule brutalement pour des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. Au lever du jour, des commandos armés franchissent la frontière depuis Gaza, s’emparant de villages, pénétrant dans les kibboutz, investissant un festival de musique en plein air. La violence frappe indistinctement : des familles entières sont massacrées, des civils pris en otage ou exécutés, des vies déchirées sous la terreur.
Ce matin-là, l’attaque ne se contente pas de semer des morts : elle laisse une société en état de sidération, marquée au fer rouge par une sauvagerie qui évoque les plus sombres pages de l’histoire européenne. Beaucoup en Israël et ailleurs parlent de « pogrom », soulignant la dimension communautaire, exterminatrice, antisémite de l’attaque, et la rupture qu’elle impose dans la mémoire collective.
Sommaire
Au cœur de la violence collective
Pour comprendre la portée du mot « pogrom », il faut plonger dans la Russie du XIXe siècle. À l’époque, la minorité juive vit cantonnée dans la « zone de résidence », soumise à une marginalisation sociale et à l’antisémitisme d’État. Le terme russe « погром » (pogrom) signifie littéralement « dévastation violente », « destruction ». Il entre dans les dictionnaires russes en 1897, au moment où l’Empire est secoué par une série d’attaques coordonnées.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Les pogroms se distinguent par leur caractère brutal, collectif, et la complicité plus ou moins active des autorités locales ou nationales. Très vite, le mot est associé aux violences antisémites et cristallise dans l’imaginaire juif la peur viscérale d’être soudain pris pour cible, sans protection possible. Au fil des décennies, il acquiert une portée universelle : toute minorité peut en être victime, mais son usage reste historiquement immergé dans la mémoire des Juifs d’Europe de l’Est.
Pogroms dans l’histoire européenne
De nombreux pogroms jalonnent l’histoire du continent, dessinant une cartographie de la haine collective. Les premières grandes vagues remontent aux temps des Croisades, dès 1096, lorsque des communautés entières d’Allemagne et d’Europe centrale sont massacrées. Le Moyen Âge s’illustre par l’horreur de Strasbourg en 1349, où près de 2 000 Juifs sont brûlés vifs, ou par les pogroms de Séville suivie de toute l’Espagne à la fin du XIVe siècle.


La Russie tsariste, à partir de 1881 et surtout après l’assassinat d’Alexandre II, devient le théâtre d’une brutalité inédite : Kiev, Odessa, Minsk, Kishinev, Jytomir, Balta, Rostov-sur-le-Don résonnent du fracas des pillages et des cris de populations traquées. Les pogroms de Kichinev (1903 et 1905) marquent les mémoires par leur violence extrême et l’impunité qui les entoure. Dans le 1er quart du XXe siècle, l’Europe orientale s’embrase : en Ukraine, Biélorussie, Pologne et Russie, les guerres et bouleversements politiques servent de prétexte à la multiplication des massacres collectifs, qui font entre 100 000 et 150 000 victimes juives en quelques années.
Sous l’occupation nazie, les pogroms changent d’échelle mais restent présents, comme à Kaunas, Lviv, Jedwabne ou Iaşi, où des milliers de Juifs sont assassinés en quelques jours. En 1946, le pogrom de Kielce en Pologne frappe les survivants revenus des camps, leur rappelant que l’antisémitisme n’a pas disparu avec la chute du Troisième Reich. À chaque fois, ce sont des foules qui se déchaînent, encouragées par la passivité, parfois la complicité, des autorités et des forces de l’ordre.


Un terme pour la mémoire, et alerter
Le mot « pogrom » porte en lui l’histoire des persécutions, mais aussi la voix de ceux qui les ont subies, racontées, transmises. Humaniser le pogrom, c’est rappeler que chaque attaque ne se réduit pas à une statistique ou à un détail historique : ce sont des vies brisées, des familles éteintes, des communautés effacées, des générations marquées au plus profond de leur chair et de leur mémoire.
L’usage du mot ne se limite pas à la description factuelle des violences. Il devient, avec le temps, un signal d’alarme moral et politique, rappelé chaque fois que la barbarie menace de se reproduire. Les commémorations – à Kishinev, Odessa, Jérusalem, au Mémorial de la Shoah – résonnent comme autant de suppliques pour ne jamais céder à l’indifférence ou à l’oubli. Par sa seule évocation, le pogrom rappelle que l’histoire n’est pas figée, que la haine peut ressurgir si elle n’est pas combattue.
Le 7 octobre 2023 ne doit plus jamais se produire.
Illustration: Représentation abstraite d’un pogrom. – Image IA