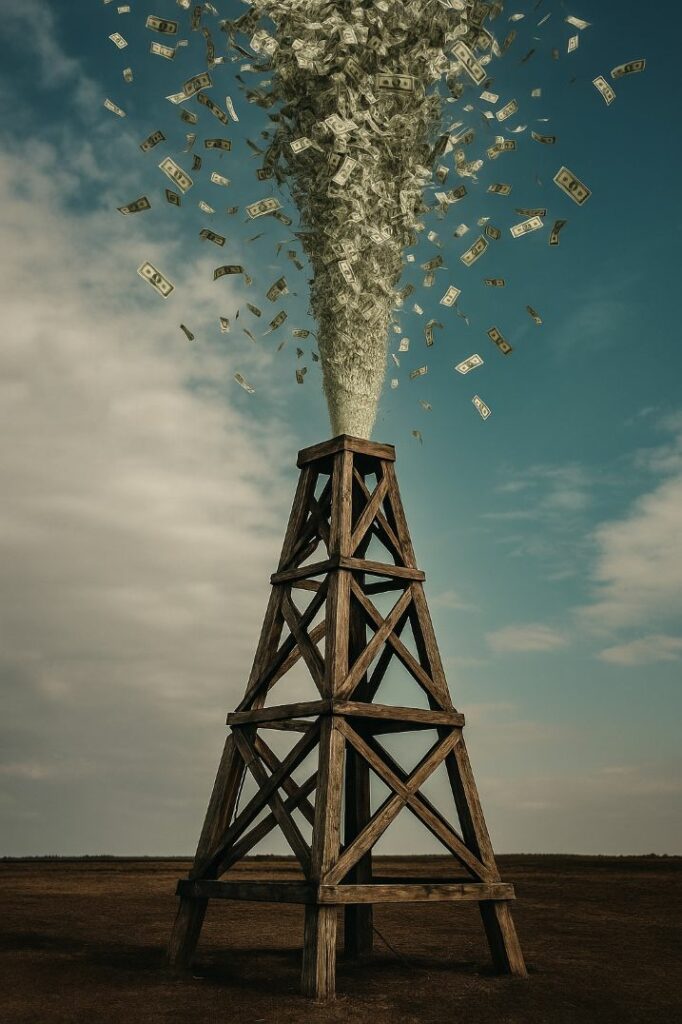Le 3 mai 1808, Madrid s’éveille dans la stupeur et l’horreur. Après le soulèvement populaire du 2 mai contre l’occupation française, la capitale espagnole subit une répression féroce orchestrée par les troupes napoléoniennes. Sur la colline du Príncipe Pío, des centaines d’Espagnols sont fusillés, marquant le début d’une guerre d’indépendance qui va embraser toute la péninsule.
Sommaire
Napoléon occupe l’Espagne
Tout commence par une manœuvre diplomatique et militaire. En 1807, Napoléon utilise le prétexte d’une expédition contre le Portugal pour faire entrer ses troupes en Espagne, avec l’accord du traité de Fontainebleau. Mais très vite, la présence française se transforme en occupation. Profitant des divisions internes de la monarchie espagnole, Napoléon convoque la famille royale à Bayonne et impose son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Les grandes villes tombent les unes après les autres, et la France pense tenir l’Espagne sous sa coupe.
L’espagne se soulève spontanément
Mais l’Espagne ne plie pas. Dès le 2 mai 1808, la population de Madrid se soulève. Le commandant français Joachim Murat ordonne une répression exemplaire. Tous les Espagnols en armes faits prisonniers lors de la révolte sont fusillés le lendemain sans procès. On estime qu’environ 400 personnes sont exécutées ce jour-là, en plus des centaines de morts lors des combats de la veille.
Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.
Partout, des juntes locales se mettent en place, regroupant notables, noblesse et militaires passés à l’insurrection. Ces comités organisent la mobilisation, distribuent les armes et coordonnent la lutte contre l’occupant. La résistance s’appuie sur l’armée régulière, mais aussi sur la population, qui invente la guérilla moderne : embuscades, harcèlement, sabotages. Les grandes villes comme Saragosse deviennent des bastions de la lutte, tandis que la guérilla s’étend dans les campagnes et les montagnes.
Les Espagnols cherchent également l’appui du Royaume-Uni, qui envoie un corps expéditionnaire pour soutenir la lutte contre les Français. Malgré la violence de la répression, la résistance ne faiblit pas et s’organise progressivement, unifiant les différentes forces sous la bannière de la liberté.
Joseph Bonaparte : un roi sans pouvoir
Joseph Bonaparte, parachuté roi d’Espagne par son frère, se heurte à une hostilité totale. Il tente d’appliquer des réformes inspirées du modèle français : suppression de l’Inquisition, modernisation de l’administration, création d’un parlement. Mais son autorité ne dépasse guère Madrid et quelques régions sous contrôle militaire. Les Espagnols le surnomment « el rey intruso », le roi intrus. Incapable d’imposer sa légitimité ou de pacifier le pays, Joseph reste dépendant des troupes françaises et des ordres de Napoléon qui le traite parfois comme un simple préfet plutôt qu’un souverain autonome.
Fin de la domination napoléonienne
La guerre d’indépendance espagnole s’enlise dans une guérilla sans merci. En 1813, la bataille de Vitoria marque un tournant décisif : les troupes françaises, dirigées par Joseph Bonaparte, sont vaincues par la coalition anglo-espagnole menée par Wellington. Les Français fuient, abandonnant armes et bagages. Napoléon doit rappeler ses troupes, et la libération du roi Ferdinand VII signe la fin de la domination française. L’essentiel du territoire espagnol est perdu pour la France, à l’exception de quelques places fortes comme la Catalogne. L’Espagne retrouve son indépendance, au prix d’années de sang et de souffrance.
3 mai 1808 : un symbole fort
Ce jour tragique, immortalisé par Goya dans son tableau El tres de mayo de 1808, incarne la brutalité de l’occupation napoléonienne et la détermination du peuple espagnol à défendre sa liberté. Ce jour-là, Madrid devient le théâtre d’un massacre qui choque l’Europe et galvanise la résistance. Aujourd’hui encore, cette date résonne comme le point de départ d’une guerre d’indépendance qui a changé le visage de l’Espagne.
Illustration: Les Désastres de la Guerre, planche n° 02, Avec ou sans raison – Musée du Prado – Wikipédia